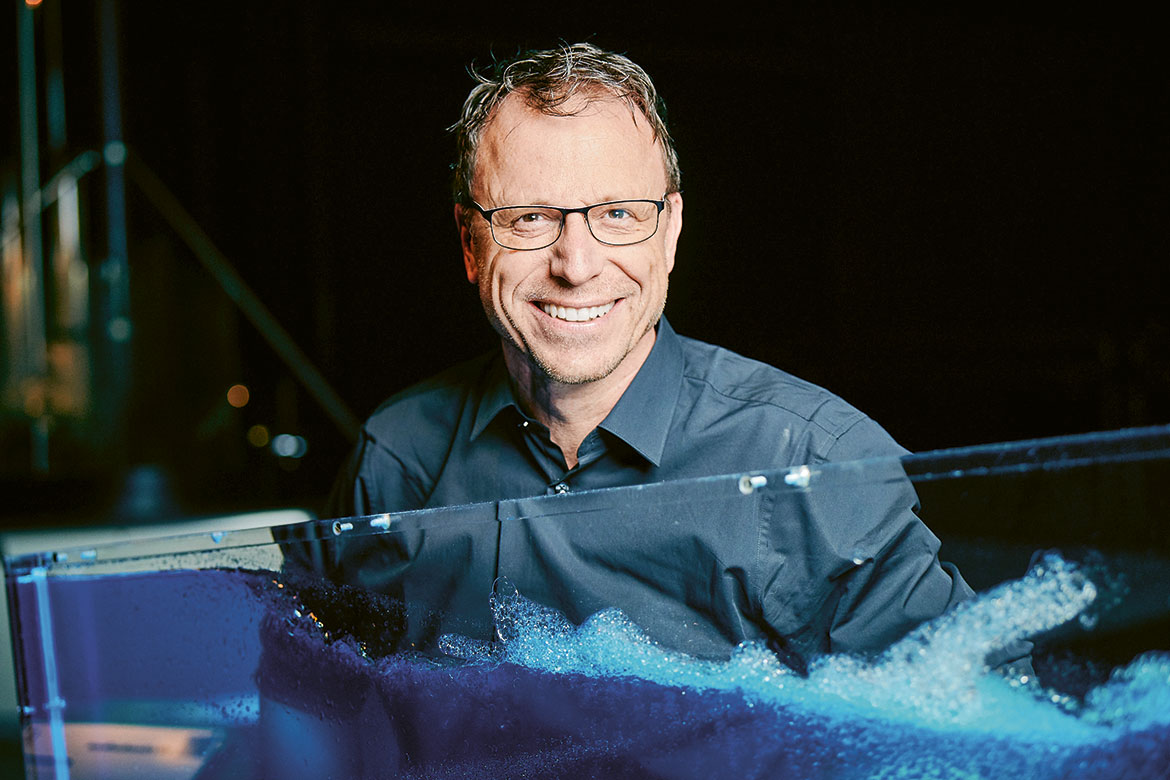Le piège de l’expertise forensique
L’expertise forensique contribue à élucider des crimes, mais peut aussi provoquer des erreurs judiciaires. Pour l’éviter, il faut mieux expliquer tant le pouvoir de la science que ses limites.

Illustration: Johanna Schaible
Le cas de l’Américaine Amanda Knox a fait la une dans le monde entier: en 2009, l’étudiante d’échange est condamnée à vingt-six ans de prison en Italie pour le meurtre sanglant de sa colocataire britannique. Des traces d’ADN pouvant être attribuées aussi bien à Amanda Knox qu’à la victime avaient été retrouvées sur l’arme présumée du crime. Dans le procès, les conclusions des enquêtes forensiques avaient joué un rôle déterminant. Mais deux ans plus tard, un tribunal d’appel casse le jugement en raison de doutes sur les analyses ADN. L’Américaine est ensuite condamnée une seconde fois, puis définitivement acquittée en 2015.
Dans cette affaire, les criminalistes ont accumulé un fatras d’erreurs, constate la juriste et criminologue Joëlle Vuille. Par exemple, ils n’ont pas systématiquement changé leurs gants pour collecter différentes traces, ont utilisé lors d’une analyse des quantités trop faibles d’ADN pour l’appareillage utilisé, et ont tiré des conclusions discutables d’échantillons contenant l’ADN de plusieurs personnes.
Aucune recherche approfondie n’existe encore sur la fréquence des erreurs judiciaires dues aux assertions d’experts scientifiques. Le taux est probablement plus bas en Europe qu’aux Etats-Unis, principalement en raison des systèmes juridiques différents. «Dans les pays anglo-saxons, les experts travaillent pour l’accusation et, consciemment ou non, ils se sentent obligés de trouver des éléments à charge», dit Joëlle Vuille. En Europe continentale en revanche, ils sont le plus souvent mandatés par un magistrat neutre et ne s’estiment être les obligés de personne.
Incompréhension fatale
L’actualité a mis en évidence un nombre toujours plus élevé de cas où des expertises forensiques ont conduit à des erreurs judiciaires. La criminologue les rassemble et cherche à en comprendre les causes dans le cadre d’une étude menée à l’Université de Neuchâtel: «Un des problèmes vient du manque de fiabilité de certaines méthodes scientifiques.» L’analyse des morsures fournit à ses yeux un exemple révélateur: l’identification d’une denture par les traces laissées dans la chair d’une victime repose uniquement sur l’expérience particulière de l’expert mandaté. Il n’existe pratiquement aucune étude scientifique sur le sujet et de méthode validée. L’analyse des empreintes de chaussures, des traces de pneus et la comparaison des cheveux et des fibres ont également été critiquées dans les dernières années. Et le cas d’Amanda Knox montre que des méthodes prétendument fiables telles que les analyses d’ADN ont aussi leurs limites.
Mais pour Joëlle Vuille, le problème le plus sérieux réside certainement dans la communication défaillante entre les tribunaux et les experts. «Nous avons d’un côté des juristes qui n’ont pas la moindre idée des sciences et de l’autre des scientifiques qui n’ont jamais appris à s’exprimer de manière à être compris par les juristes.» Elle déplore surtout que les juristes ne doivent pas suivre le moindre cours de sciences naturelles durant leur formation: «L’idée qu’ils se font de la criminalistique provient souvent des séries télévisées et des films.» Qui présentent généralement les sciences comme omniscientes et infaillibles.
Mais des mathématiciens remettent en question l’analyse de l’expert. Il s’est grossièrement trompé: la probabilité d’une coïncidence n’est que de 1 sur 26 et, surtout, il n’aurait jamais dû présenter au tribunal un calcul isolé sans le comparer avec les probabilités d’explications alternatives. C’est le problème bien connu du «sophisme du procureur»: le gagnant de l’Euromillions n’est probablement pas un tricheur, même s’il n’a qu’une chance sur 130 millions de gagner.
Les experts lancent une pétition et demandent en 2008 la réouverture du procès. Après des années de prison, Lucia de Berk est rejugée. Elle est acquittée le 14 avril 2010. Un mauvais calcul de probabilité mal présenté a aveuglé la justice et broyé la vie d’une infirmière qui faisait tout simplement son travail. <i>dsa</i>
La communication avec les juristes constitue une part essentielle de son travail, note Eva Scheurer, directrice de l’Institut de médecine légale de la ville de Bâle. Ce dernier rédige chaque année 14 000 rapports, expertises et évaluations dans les domaines de la médecine légale, de la toxicologie ainsi que de la génétique et chimie forensiques, la plupart sur mandat du ministère public ou de la police. «Mon rôle est de jouer les interprètes entre scientifiques et juristes, poursuit Eva Scheuer. Par principe, nous n’employons aucun terme spécialisé dans nos expertises; au contraire, nous présentons la situation en langage courant.» Au besoin, elle fournit également des explications de base: ainsi, l’exposé des processus métaboliques peut aider un juge à mieux comprendre le résultat d’un examen toxicologique. Eva Scheurer évite en outre de présenter ses résultats sous la forme de pourcentages dans les évaluations destinées à des procédures pénales. «Dire qu’il y a 45 ou 55% de chances qu’un objet déterminé constitue l’arme du crime n’est guère parlant. Cela ne répond pas à la question que se pose le tribunal.» Si plusieurs instruments entrent en considération comme arme du crime, la spécialiste explique lequel est plus ou moins vraisemblable et pourquoi.
Autre problème: les experts sont assez rarement invités dans notre pays à s’exprimer devant un tribunal. Ils ne reçoivent en général pas de retour et ignorent donc si le tribunal a interprété correctement les explications données. Pour y rémédier, Eva Scheurer veut organiser des séminaires dans lesquels des juristes devront donner un feedback direct aux médecins légistes après avoir lu des expertises anonymisées.
Comparer les scénarios
Le Réseau européen des instituts de sciences forensiques (ENFSI), lui, plaide pour une approche quantitative avec un recours systématique aux chiffres et aux probabilités. «A notre avis, ils permettent d’éviter les malentendus entre tribunaux et scientifiques», explique Tacha Hicks Champod, de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Les lignes directrices publiées par l’ENFSI en 2015 recommandent aux experts scientifiques de communiquer leurs résultats en comparant des scénarios alternatifs à l’aide rapports de vraisemblance, par exemple «il est 2000 fois plus vraisemblable de rencontrer les caractéristiques réunies par cette empreinte si elle vient effectivement de la chaussure du suspect que si l’on postule qu’elle est due à une autre chaussure». En revanche, il faut éviter des déclarations vagues telles que: «L’empreinte correspond aux caractéristiques de la chaussure du suspect.» Cette approche se révèle cependant problématique dans les domaines de la forensique qui ne s’appuient pas sur des méthodes standardisées mais sur des éléments empiriques. «Dans de nombreuses disciplines classiques, nous disposons des connaissances voulues, mais pas de données structurées, reconnaît Tacha Hicks Champod. Il est important d’intensifier les recherches dans ces domaines.» Un projet de son institut lausannois vise actuellement à établir une méthode statistique fiable pour comparer des signatures manuscrites.
Quelle que soit l’approche, les spécialistes répètent à l’unisson que la transparence des rapports d’évaluation est une priorité. Ils doivent suivre une structure logique: décrire avec précision la procédure suivie, mentionner les sources éventuelles d’erreur et énoncer clairement les limites de la science. «On ne saurait jamais exclure quelque chose à 100%, dit Eva Scheurer. Il y a toujours une certaine marge d’interprétation des résultats.» Qu’un juge demande une deuxième expertise qui, éventuellement, donnera une autre interprétation de ses constats ne la dérange pas. «Il ne s’agit pas d’avoir raison, mais de trouver la vérité.» Le juge décide lui-même à quelle évaluation il accordera la priorité pour formuler son jugement. Au final, c’est le tribunal qui tranche sur l’innocence ou la culpabilité d’un accusé. Pas la science.
Yvonne Vahlensieck est une journaliste indépendante établie près de Bâle.