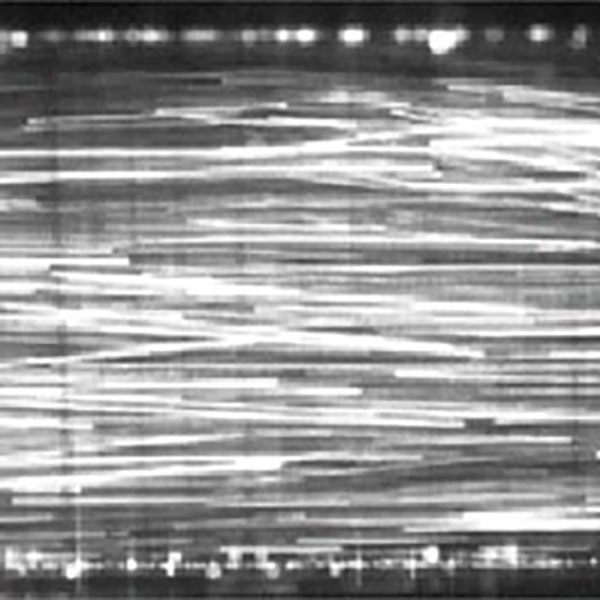Dossier: Publications en mutation
Des impulsions créatives nées en Suisse
Le monde de l’édition scientifique évolue également grâce à des idées nouvelles en Suisse. Survol en cinq exemples.
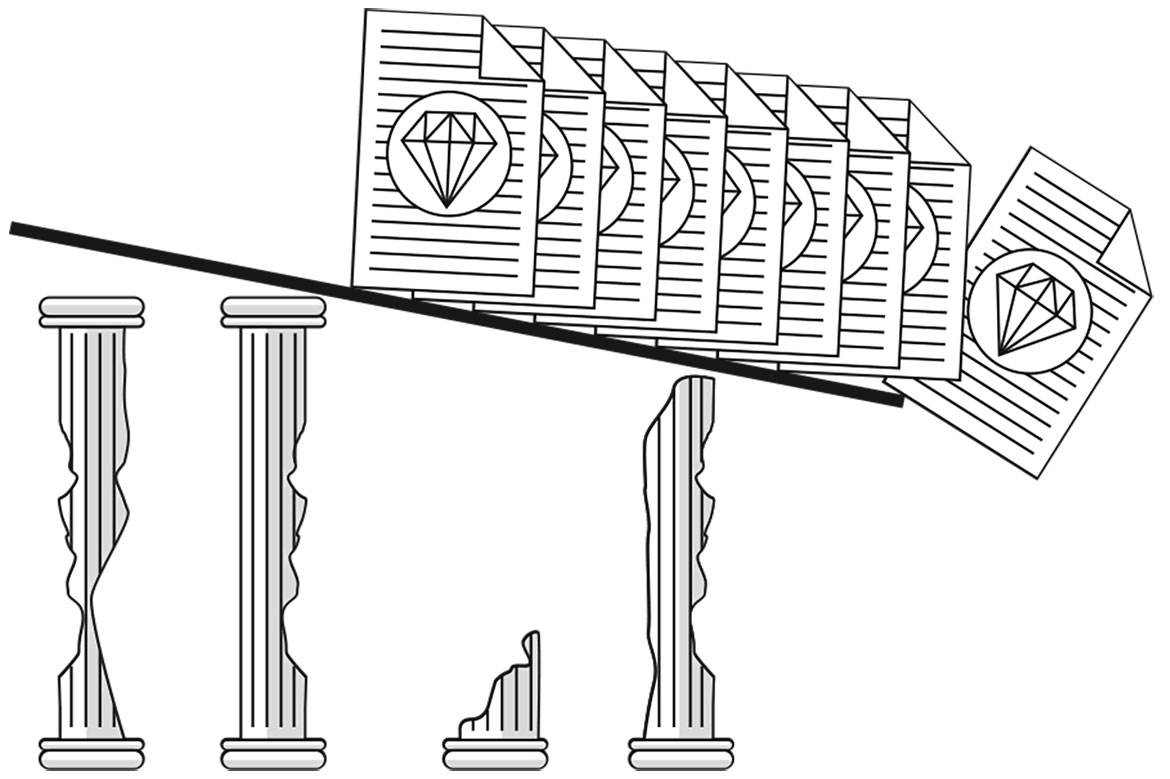
Le Diamond Open Access du Swiss Medical Weekly repose sur un financement par des membres temporaires. | Illustration: Anna Haas
Pas d’abonnement, pas de frais de publication
Le Swiss Medical Weekly (SMW) suit avec fierté la voie «diamant» de l’open access: il est entièrement gratuit autant pour le lire que pour y publier. Il ne veut pas faire payer les auteurs, car «les revenus dépendent alors du nombre d’articles publiés, ce qui inciterait à accepter davantage de soumissions et donc à baisser la qualité», explique la directrice Natalie Marty. Le principal journal suisse des sciences médicales dépend ainsi presque entièrement du financement octroyé par la vingtaine d’institutions membres de l’association de soutien – notamment des hôpitaux et associations médicales, dont la Fédération des médecins suisses (FMH). Les universités et le secteur privé en sont absents. «Ce dernier serait susceptible d’affaiblir l’image d’indépendance du journal, commente la directrice. Le milieu hospitalier a vite reconnu l’utilité d’une revue médicale qui traite de la situation locale et publie des articles écrits par des médecins-chercheurs. Nos éditeurs donnent de nombreux feedback pour améliorer les manuscrits, ce qui contribue à la formation des scientifiques en début de carrière.»
Les soutiens sont planifiés pour trois ans, ce qui exige une recherche permanente de nouveaux membres, «un mode de fonctionnement de start-up qui n’est pas viable à long terme», selon la directrice. Le rédacteur en chef du SMW, Adriano Aguzzi, de l’Hôpital universitaire de Zurich, a exposé sa vision dans Nature en 2019: les organismes de financement de la recherche, tels que le Fonds national suisse, devraient octroyer des soutiens financiers aux revues en diamond open access de manière compétitive, jugeant par exemple le taux d’acceptation des manuscrits, les délais, l’archivage, la gestion des rétractations ou encore des innovations telles que le peer review après publication. Une liste qui ressemble d’ailleurs aux points forts du SMW: le journal rejette 70% des soumissions, mais délivre les rapports de peer review en trois semaines en moyenne et duplique son contenu dans les archives publiques Clockss, un outil qui assure que les articles publiés resteraient accessibles même si – malheur – la revue devait fermer boutique.
Le SMW célèbre ses 150 ans en 2021 et semble bien tourner, avec un coût raisonnable de 1700 francs en moyenne par article publié. Il se permet même de commander parfois une évaluation externe des statistiques présentées dans les manuscrits, et de rémunérer symboliquement, à hauteur de 50 francs, le travail des referees.
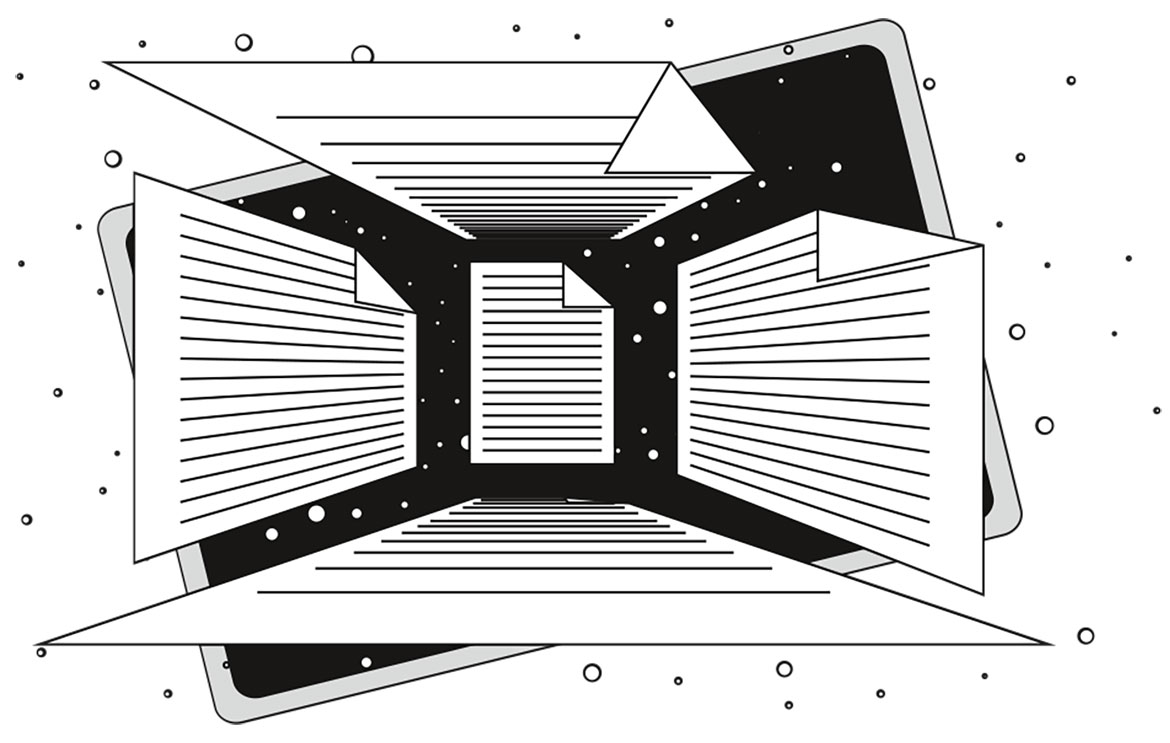
Les anthologies multimédia en ligne pour la poésie permettent de découvrir de nouveaux univers. | Illustration: Anna Haas
La poésie réinvente la publication académique
L’édition scientifique numérique se contente encore souvent de mettre en ligne des articles sous forme de textes ou de fichiers PDF statiques. Et un coup d’œil aux livres académiques interactifs de l’éditeur genevois Metispresse déçoit: après avoir installé un logiciel de lecture ad hoc, on découvre un texte illisible aux caractères mélangés et à l’interactivité défaillante.
Un spécialiste de la poésie de l’Université de Lausanne veut changer la situation. Antonio Rodriguez développe notamment des anthologies multimédias de poésie en ligne. «Les versions traditionnelles imprimées sont déterminées par un choix unique – une classification qui peut être thématique, historique ou géographique des poèmes, explique le chercheur. Nos versions numériques permettent d’explorer de nouvelles combinaisons et, ainsi, des analyses critiques inédites.» Autre initiative de son équipe: élaborer un dictionnaire interactif de 24 concepts de l’analyse poétique, afin de pouvoir les comparer dans différentes langues. Mais ces innovations peuvent se heurter à des obstacles institutionnels comme obtenir des référencements de contenus numériques, appelés DOIs.
Autre exemple: l’équipe lausannoise désire publier ses travaux sur le mouvement du primitivisme en poésie sous la forme d’un catalogue interactif des contributions. Mais le FNS n’a pas soutenu ce point financièrement, raconte Antonio Rodriguez: l’institution semble craindre une plateforme non professionnelle de qualité insatisfaisante et renvoie aux maisons d’édition traditionnelles, alors que celles-ci «ne s’engagent que timidement dans ce genre de projets interactifs».
Pour innover, il faut sortir des sentiers battus de l’édition scientifique. «Il y a quelques barrières à l’innovation en Suisse, mais aussi beaucoup d’encouragements, poursuit Antonio Rodriguez. Après tout, deux des trois projets de publication interactive de mon équipe ont pu se réaliser. Je nous vois comme des pionniers, mais aussi un peu comme des cobayes. C’est au fur et à mesure que nous découvrons les problèmes et les résolvons. Partager nos expériences est très important: notre but n’est pas d’innover pour innover, mais de mettre en place de nouvelles manières durables de présenter l’information scientifique.»
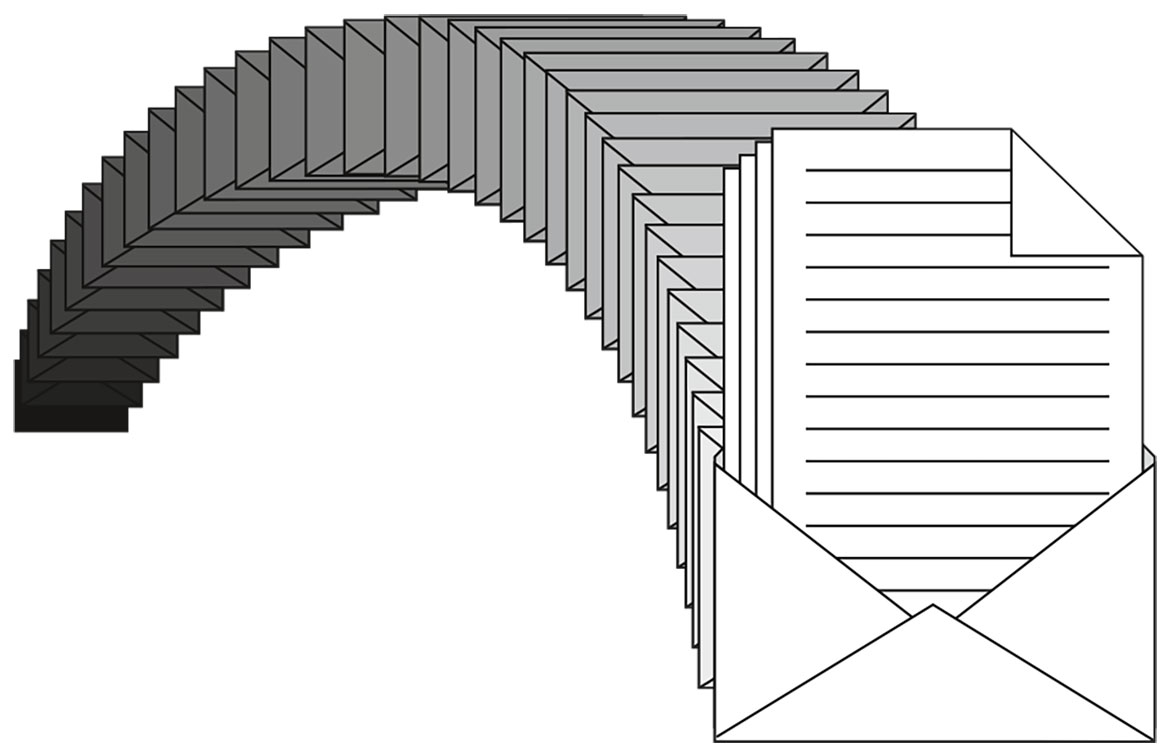
Les éditeurs open access commerciaux génèrent leurs revenus grâce aux frais de publication: la quantité est une bonne affaire. | Illustration: Anna Haas
Un poids lourd suisse qui fait débat
Deux des plus grands acteurs mondiaux de l’open access se trouvent en Suisse: MDPI à Bâle avec 166 000 articles publiés en 2020 (une augmentation de 51% par rapport à 2019) et Frontiers à Lausanne et ses 48 000 articles (plus 45%).
L’essor spectaculaire de MDPI serait-il lié aux pratiques douteuses qu’on retrouve dans les revues prédatrices? C’est la question que pose l’économiste Paolo Crosetto sur son blog. Il relève que la croissance de MDPI est principalement due à celle des special issues: des numéros qui rassemblent des articles autour d’un thème particulier et dont la direction est confiée à un scientifique du domaine invité. Il dénombre en 2020 une moyenne stupéfiante de 100 numéros spéciaux par journal, le journal Sustainability en comptant même plus de 3000, contre ses 24 numéros habituels par année. Recruter les milliers d’éditeurs invités passe par des envois massifs d’e-mails – une pratique qui dérange, notamment lorsqu’ils arrivent chez des scientifiques qui travaillent dans un domaine éloigné de celui recherché. A leur tour, les éditeurs invités doivent convaincre des collègues de soumettre des articles, ce qui génère une nouvelle avalanche d’e-mails. «Comme toute entreprise digitale, nous utilisons les e-mails pour identifier notre clientèle et communiquer avec elle, répond Stefan Tochev, responsable de la communication de MDPI. Nous voulons motiver les scientifiques à stimuler des discussions dans leur communauté.»
Christos Petrou de Scholarly Intelligence note dans une analyse que MDPI a amélioré sa réputation, rejette 60% des manuscrits soumis et offre une rapidité inégalée sur le marché avec une publication faite en moyenne en moins de six semaines – un avantage qui peut attirer des auteurs.
En ligne, les avis de la communauté sont partagés. Certains disent avoir fait de bonnes expériences avec MDPI, d’autres ont décidé de ne plus évaluer les manuscrits soumis, se plaignant de pressions pour accepter une grande proportion d’articles. C’est le cœur du problème: les éditeurs commerciaux d’open access tirent leurs revenus des frais de publication perçus pour chaque article publié. Leurs actionnaires – et le management – sont donc incités à en avoir le plus possible.
Malgré les voix critiques, les deux entreprises helvétiques Frontiers et MDPI occupent respectivement le 3e et le 7e rang des éditeurs dont les articles sont le plus souvent cités – devant des concurrents à la réputation irréprochable tels que Springer Nature ou Oxford University Press.
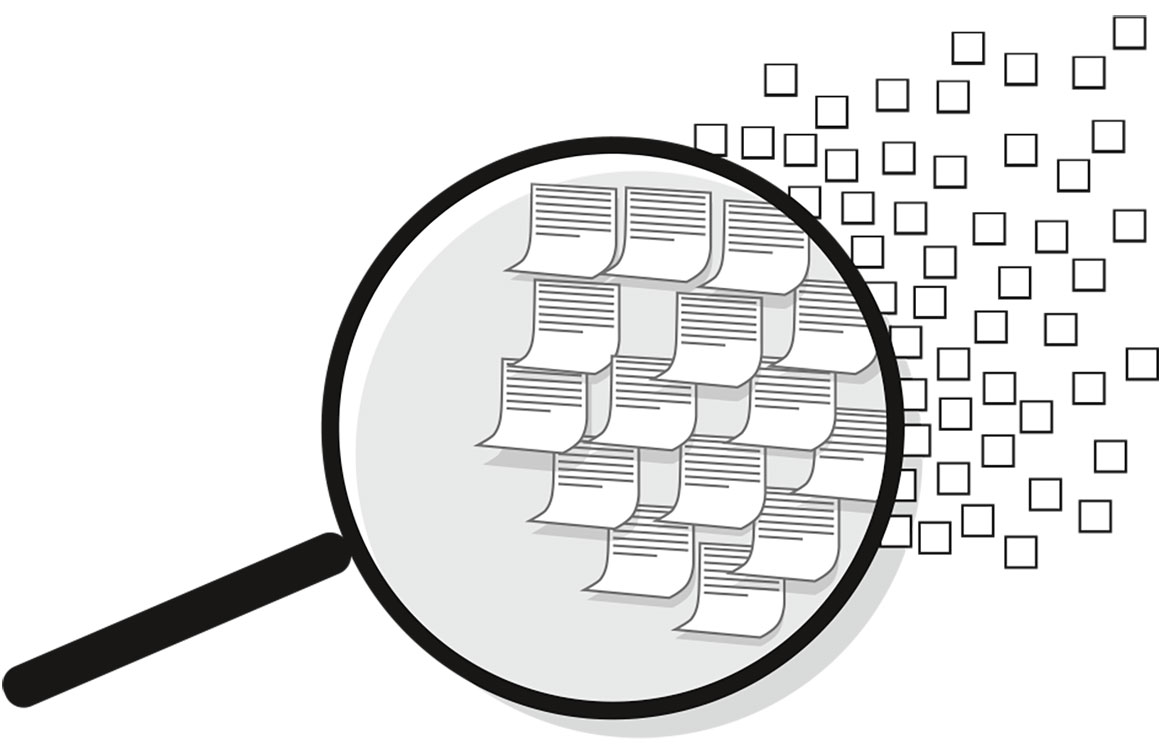
Publier observation par observation aurait dû accélérer la recherche et la rendre plus honnête. | Illustration: Anna Haas
La start-up qui voulait révolutionner la publication
L’idée est séduisante: lancée à Zurich en 2016, la revue Matters publie uniquement des observations scientifiques individuelles. Les chercheurs peuvent ainsi communiquer leurs résultats petit à petit, sans attendre d’en accumuler suffisamment pour rédiger un article complet. De quoi accélérer la recherche, réduire la tentation d’enjoliver ses messages et favoriser la publication des résultats incrémentaux, peu spectaculaires ou négatifs. Le journal tire ses revenus des frais de publication (150 francs par observation) et des forfaits annuels allant de 5000 à 50000 francs et donnant le droit à une université de publier 50 articles.
Le bilan est mitigé. En septembre 2021, le site internet de la revue Sciencematters.io ne fonctionne pas depuis quatre mois et les e-mails ne sont pas délivrés. «Nous avons eu un problème avec le renouvellement automatique du nom du domaine internet, explique le directeur, Lawrence Rajendran, un neuroscientifique aujourd’hui basé à Londres. Cela devrait se régler rapidement.» (ndlr, en novembre dernier, le problème n’était pas encore résolu) Un problème de taille: à moins d’avoir été auto-archivés ailleurs par les auteurs, les articles ne sont plus accessibles, un comble pour une publication en libre accès. Et le modèle ne semble pas avoir pris, avec seulement 150 observations publiées depuis le lancement. «C’est trop peu, bien sûr. En fait, c’est moins que le nombre de personnes à qui j’ai parlé pour développer le projet», ironise le directeur. Comment analyser cet échec? «Je vois une grande hypocrisie dans le monde académique, répond-il. D’un côté, les institutions déclarent vouloir changer le système, favoriser l’open access et le partage des données de la recherche. De l’autre, elles encouragent leur personnel à publier dans des journaux prestigieux afin d’améliorer leur profil et les chances de financement. Même les gens qui ont soutenu Matters y ont soumis très peu d’observations, par crainte de ne pas pouvoir publier plus tard un article ailleurs.»
Des scientifiques impliqués dans le projet critiquent un management chaotique et le fait que les projets ont été mal priorisés, comme le développement d’un système basé sur la blockchain. Poursuivre une carrière académique et diriger une start-up: était-ce raisonnable? «J’ai dû tout apprendre pour Matters, un projet énorme, et pour lequel je ne me suis jamais versé de salaire. Mon espoir était qu’une grande institution helvétique utilise Matters pour lancer sa propre publication. Avec le recul, j’aurais tenté une alliance avec de grands éditeurs tels qu’Elsevier ou Springer Nature», note Lawrence Rajendran.
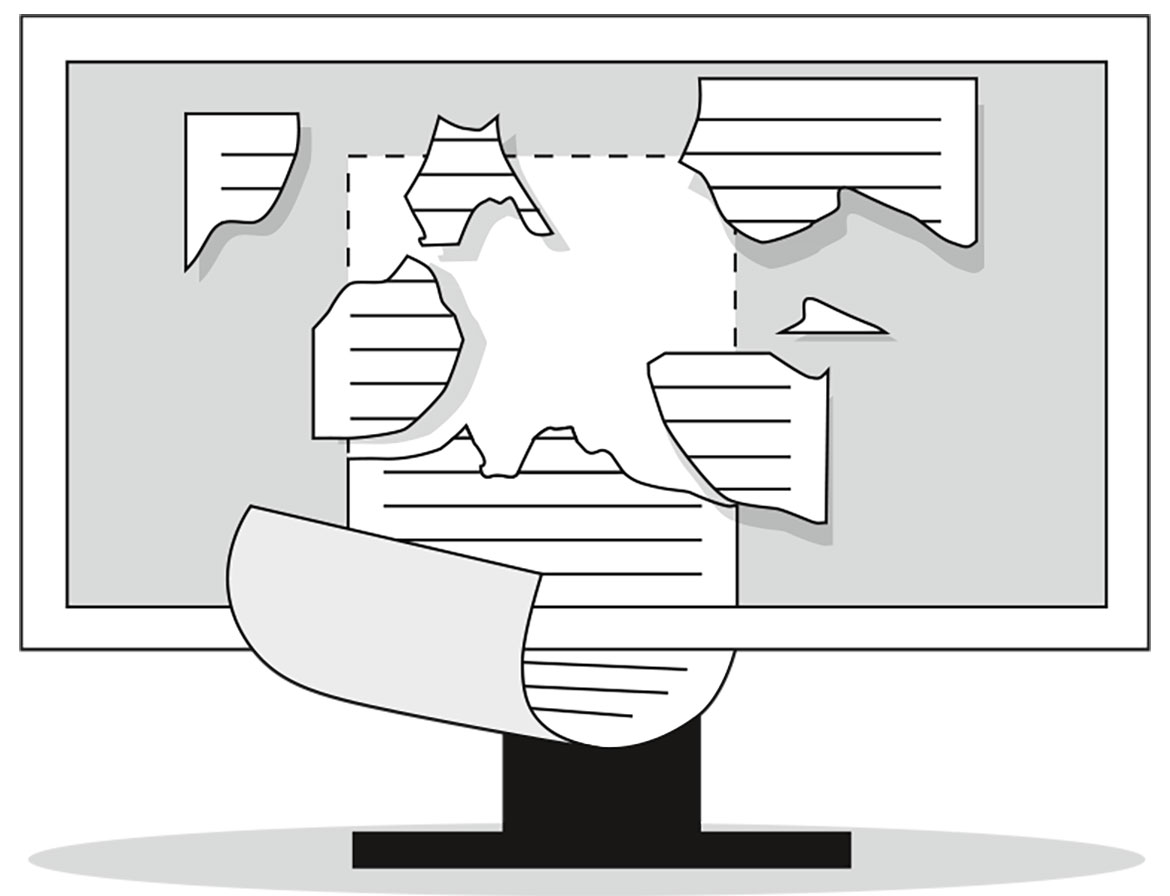
L'algorithme combine parfois plus honnêtement les parties du travail en résumés que le font les chercheurs. | Illustration: Anna Haas
La machine écrit le résumé
Professeur de neuro-informatique à l’ETH Zurich, Richard Hahnloser développe des algorithmes d’intelligence artificielle afin de faciliter l’écriture d’articles scientifiques. «Rédiger constitue une tâche très intéressante lorsqu’il s’agit de partager ce que l’on sait. Mais elle peut être rébarbative quand on doit chercher la bonne référence dans la littérature, la télécharger, l’insérer dans son logiciel de références, l’annoter... Tout cela freine la réflexion créative. C’est ma motivation principale pour ce projet.»
Son équipe développe un éditeur de texte qui permet d’effectuer des recherches bibliographiques en temps réel. En plus des mots-clés utilisés dans les outils usuels, le prototype exploite des extraits du texte rédigé sur la plateforme que l’usager sélectionne. L’algorithme classe alors les articles identifiés dans la littérature selon leur degré de similarité sémantique avec le passage sélectionné – une approche différente des moteurs usuels qui se basent sur le nombre d’apparitions des mots-clés.
«On peut ainsi rapidement identifier les bonnes références sans devoir jouer avec les différentes combinaisons de mots-clés, poursuit-il. C’est utile lorsqu’on écrit l’introduction d’un article – une partie contenant de très nombreuses références à des travaux antérieurs – ou qu’on rédige un plan de recherche dans un nouveau domaine encore peu connu et qu’on doit identifier les études pertinentes.» Pour effectuer la comparaison sémantique, le prototype utilise un modèle de langage – similaire au fameux GPT-3 – qui résume tout texte en un vecteur caractérisé par 256 paramètres; la distance entre deux vecteurs signale à quel point le sens des deux textes se rejoint.
L’équipe de recherche planche également sur des algorithmes qui résument des articles scientifiques. Cela permettra à une chercheuse d’explorer efficacement la littérature sans avoir à lire l’intégralité des articles. Pourquoi ne pas simplement utiliser l’abstract officiel de chaque article? «Les abstracts rédigés par les auteurs visent parfois davantage à convaincre leurs collègues de lire l’article plutôt qu’à résumer son contenu de manière claire, compréhensible et honnête, constate Richard Hanloser. Nos résumés automatiques sont en général précis et informatifs. Nous avons d’ailleurs testé notre algorithme sur l’article qui expliquait son fonctionnement: j’ai trouvé le résultat meilleur que celui que j’avais moi-même rédigé. Je me suis aperçu, mais un peu trop tard, que nous aurions pu en fait utiliser notre résumé automatique dans la version publiée!»