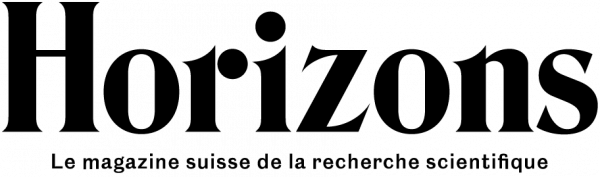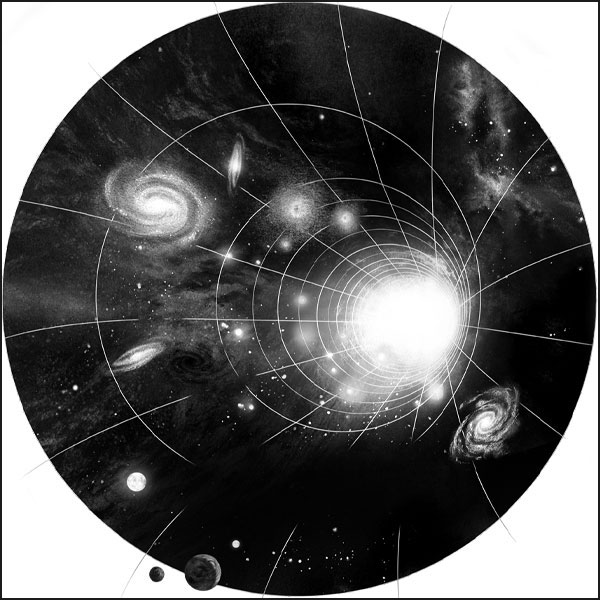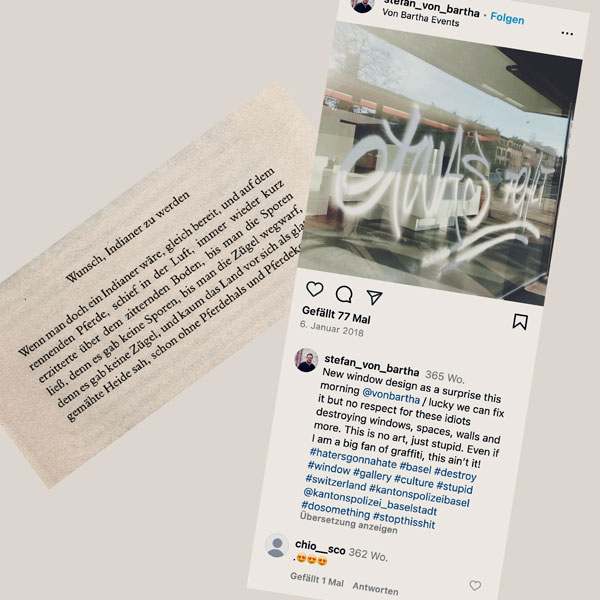DÉBAT
Est-il sensé d’envoyer des humains dans l’espace?
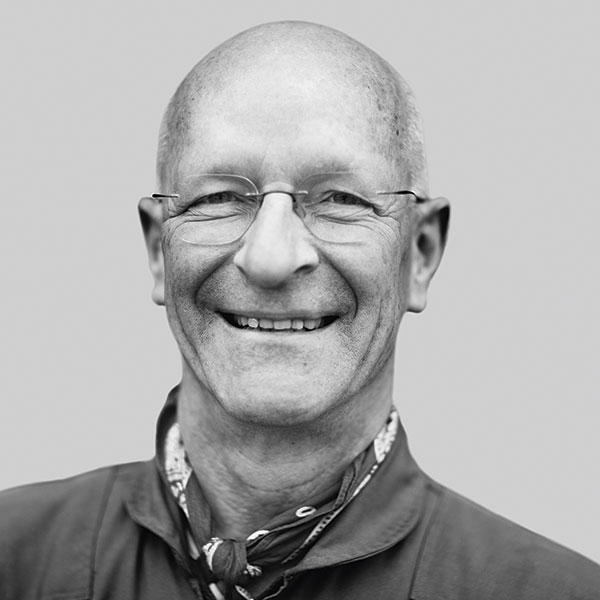
Photo: Gaetan Bally / Keystone

Photo: màd
Je m’étonne toujours que des personnes profondément engagées dans la recherche en astrophysique puissent, en toute bonne conscience, répondre non à cette question. Un grand nombre d’entre elles utilisent les résultats du télescope Hubble, lequel serait resté totalement inutilisable sans des interventions humaines en orbite, cinq en tout, entre 1993 et 2009. Bien sûr, on me dira: «Maintenant, on a le télescope spatial James Webb, le grand frère de Hubble, travaillant dans l’infrarouge, qui fonctionne parfaitement sans de coûteuses et dangereuses missions spatiales habitées pour s’en occuper.» Cela est vrai, mais on ne va pas faire de la statistique avec seulement ces deux télescopes spatiaux.
Par ailleurs, en novembre 2019, il y a eu une autre intervention d’astronautes sur un instrument scientifique de valeur, l’Alpha Magnetic Spectrometer, installé sur la Station spatiale internationale. Ce détecteur à antimatière vise notamment à mieux comprendre l’origine de l’Univers. Le succès de son sauvetage, alors qu’il n’avait pas été conçu pour des réparations en orbite, a clairement démontré que l’homme dans l’espace n’est pas là «juste pour son plaisir». Dans un passé récent, les vols spatiaux habités ont donc magnifiquement servi la science.
Il y a, bien sûr, un autre aspect de ces vols qui suscite le débat: cette idée d’une base habitée au pôle Sud de la Lune, pour des séjours de longue durée d’astronautes du programme de la NASA Artemis et de la Chine. L’objectif d’Artemis est essentiellement scientifique, mais aussi considéré comme une étape de préparation pour de futures envolées habitées vers Mars. Je ne suis pas en faveur d’une colonisation prochaine de la planète rouge, qui est la vision d’Elon Musk.
Mais l’exploration de Mars par des équipes d’astronautes aura certainement lieu dans le futur. C’est un défi technique et opérationnel majeur, mais cela peut aussi constituer une très grande source d’inspiration qui suscite de fortes émotions, comme le programme lunaire Apollo il y a un demi-siècle. Et c’est aussi une tentative de réponse à une question d’un grand intérêt: l’homme est-il capable de vivre, à long terme et en bonne santé, ailleurs que sur la Terre?
Claude Nicollier est membre de la Commission fédérale pour les affaires spatiales et professeur honoraire à l’EPFL. Astrophysicien, il a été le premier astronaute suisse.
Perseverance, Juice, BepiColombo, et tant d’autres… Ces petits robots de l’espace explorent notre système solaire, nous envoyant des images, des échantillons, des données physiques qui nous permettent de comprendre la formation des planètes et leur évolution. Chaque génération de sondes est plus performante que la précédente, et l’essor rapide de l’intelligence artificielle laisse augurer un progrès significatif à venir: le moment où ces petits robots seront capables de prendre des décisions quant à leur mission, rendant parfaitement superflu l’envoi d’humains à leur place ou à leurs côtés.
Ces sondes ont une particularité essentielle: elles n’ont besoin ni de respirer, ni de manger, ni d’être protégées des radiations. Tout l’effort financier pour leur mise au point peut être consacré à maîtriser leur envoi et à augmenter leurs performances. Les missions habitées, au contraire, sont plombées par le coût exorbitant de la nécessité d’assurer la survie des voyageurs humains dans des conditions supportables.
L’être humain est un explorateur, il ne s’est jamais contenté de son petit chez-soi. Après avoir exploré la Terre, il a naturellement tourné son regard vers le ciel. Après l’exploit temporaire de la conquête de la Lune, les stations spatiales ont assuré sa présence à long terme dans l’espace. Cela a permis de comprendre toutes sortes de choses sur notre physiologie, et en particulier que l’impesanteur agissait extrêmement négativement sur les organismes vivants. Le stress métabolique induit par le bouleversement de l’équilibre des fluides dans le corps, ajouté à l’augmentation de l’exposition aux rayonnements, entraîne des pathologies plus ou moins graves ou handicapantes qui montrent à quel point nos organismes sont fragiles lorsqu’on les extrait de leur milieu naturel évolutif.
Les ressources financières des nations ne sont pas extensibles à l’infini. A l’heure où les défis ne se comptent plus pour assurer une vie digne aux Terriennes et aux Terriens, il est absurde de consacrer des sommes faramineuses à des missions habitées alors que l’exploration robotique dans l’espace engrange de tels succès.
Sylvia Ekström astrophysicienne à l’Université de Genève, est spécialiste en physique des étoiles. En 2020, elle a écrit un livre intitulé «Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs».
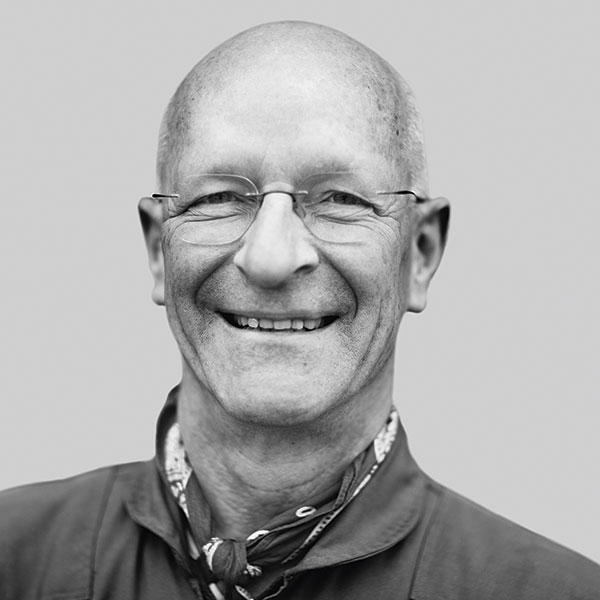
Photo: Gaetan Bally / Keystone
Je m’étonne toujours que des personnes profondément engagées dans la recherche en astrophysique puissent, en toute bonne conscience, répondre non à cette question. Un grand nombre d’entre elles utilisent les résultats du télescope Hubble, lequel serait resté totalement inutilisable sans des interventions humaines en orbite, cinq en tout, entre 1993 et 2009.
Bien sûr, on me dira: «Maintenant, on a le télescope spatial James Webb, le grand frère de Hubble, travaillant dans l’infrarouge, qui fonctionne parfaitement sans de coûteuses et dangereuses missions spatiales habitées pour s’en occuper.» Cela est vrai, mais on ne va pas faire de la statistique avec seulement ces deux télescopes spatiaux. Par ailleurs, en novembre 2019, il y a eu une autre intervention d’astronautes sur un instrument scientifique de valeur, l’Alpha Magnetic Spectrometer, installé sur la Station spatiale internationale. Ce détecteur à antimatière vise notamment à mieux comprendre l’origine de l’Univers. Le succès de son sauvetage, alors qu’il n’avait pas été conçu pour des réparations en orbite, a clairement démontré que l’homme dans l’espace n’est pas là «juste pour son plaisir». Dans un passé récent, les vols spatiaux habités ont donc magnifiquement servi la science.
Il y a, bien sûr, un autre aspect de ces vols qui suscite le débat: cette idée d’une base habitée au pôle Sud de la Lune, pour des séjours de longue durée d’astronautes du programme de la NASA Artemis et de la Chine. L’objectif d’Artemis est essentiellement scientifique, mais aussi considéré comme une étape de préparation pour de futures envolées habitées vers Mars.
Je ne suis pas en faveur d’une colonisation prochaine de la planète rouge, qui est la vision d’Elon Musk. Mais son exploration par des équipes d’astronautes aura certainement lieu dans le futur. Un défi technique et opérationnel majeur, une très grande source d’inspiration et d’émotions, comme pour le programme lunaire Apollo il y a un demi-siècle. Et une tentative de réponse à une question d’un grand intérêt: l’homme est-il capable de vivre, à long terme et en bonne santé, ailleurs que sur la Terre?
Claude Nicollier est membre de la Commission fédérale pour les affaires spatiales et professeur honoraire à l’EPFL. Astrophysicien, il a été le premier astronaute suisse.

Photo: màd
Perseverance, Juice, BepiColombo, et tant d’autres… Ces petits robots de l’espace explorent notre système solaire, nous envoyant des images, des échantillons, des données physiques qui nous permettent de comprendre la formation des planètes et leur évolution. Chaque génération de sondes est plus performante que la précédente, et l’essor rapide de l’intelligence artificielle laisse augurer un progrès significatif à venir: le moment où ces petits robots seront capables de prendre des décisions quant à leur mission, rendant parfaitement superflu l’envoi d’humains à leur place ou à leurs côtés.
Ces sondes ont une particularité essentielle: elles n’ont besoin ni de respirer, ni de manger, ni d’être protégées des radiations. Tout l’effort financier pour leur mise au point peut être consacré à maîtriser leur envoi et à augmenter leurs performances. Les missions habitées, au contraire, sont plombées par le coût exorbitant de la nécessité d’assurer la survie des voyageurs humains dans des conditions supportables.
L’être humain est un explorateur, il ne s’est jamais contenté de son petit chez-soi. Après avoir exploré la Terre, il a naturellement tourné son regard vers le ciel. Après l’exploit temporaire de la conquête de la Lune, les stations spatiales ont assuré sa présence à long terme dans l’espace. Cela a permis de comprendre toutes sortes de choses sur notre physiologie, et en particulier que l’impesanteur agissait extrêmement négativement sur les organismes vivants. Le stress métabolique induit par le bouleversement de l’équilibre des fluides dans le corps, ajouté à l’augmentation de l’exposition aux rayonnements, entraîne des pathologies plus ou moins graves ou handicapantes qui montrent à quel point nos organismes sont fragiles lorsqu’on les extrait de leur milieu naturel évolutif.
Les ressources financières des nations ne sont pas infiniment extensibles. A l’heure où les défis ne se comptent plus pour assurer une vie digne aux Terriennes et aux Terriens, il est absurde de consacrer des sommes faramineuses à des missions habitées alors que l’exploration robotique engrange de tels succès.
Sylvia Ekström astrophysicienne à l’Université de Genève, est spécialiste en physique des étoiles. Elle a écrit en 2020 un livre intitulé «Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs».