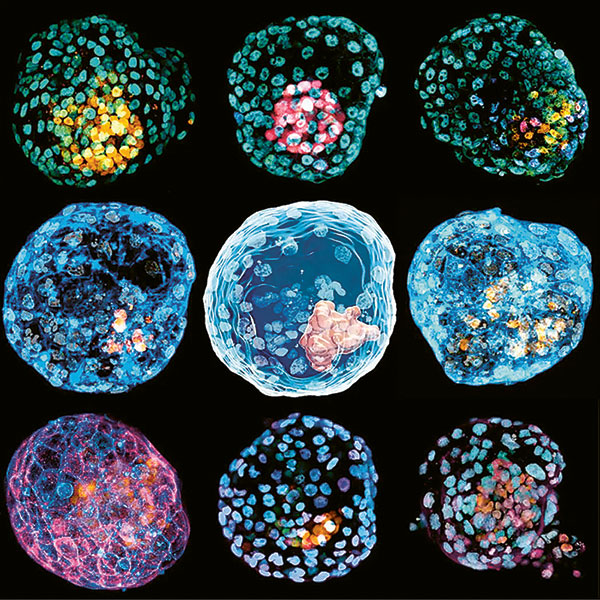REPORTAGE
Sur les traces des loups avec des gants de laboratoire
Les grands prédateurs augmentent la biodiversité d’un écosystème: davantage de nourriture pour les charognards, une herbe plus haute pour les petits mammifères. Immersion avec une équipe du Parc national.

Michael Prinz est chasseur à ses heures perdues et a toujours ses jumelles avec lui. En arrière-plan, la biologiste Pia Anderwald est prête avec son appareil GPS.| Photo: Silas Zindel
La crotte brun foncé sur le sentier de randonnée semble bien anodine. On pourrait penser que c’est un chien qui l’a laissée là. Mais les chiens sont interdits dans le Parc national suisse, afin que plantes et animaux puissent s’épanouir en toute quiétude. Par ailleurs, l’excrément contient de fins poils clairs. «Ce sont des restes du pelage de la dernière proie», dit Michael Prinz, civiliste, qui passe l’été dans le parc pour participer aux travaux de recherche. «Les déjections canines ne contiennent pas ce genre de résidus, car les chiens ne chassent pas.» L’étron est encore frais. Cela signifie qu'un loup se tenait exactement là hier ou la nuit précédente.
Quelques mois durant, les loups ont été les maîtres nocturnes du parc. Il s’agissait d’une nouvelle évolution: la première meute y est apparue en 2023 seulement. Pour les scientifiques, c'était comme s'ils avaient gagné au loto, car désormais elles pouvaient examiner comment la présence du carnivore influe sur la vie des autres animaux: ses proies comme le cerf élaphe et le chamois, mais aussi les petits mammifères comme les souris et d’autres petits prédateurs tels que le renard.
A propos de l’abattage de la meute de loups
Ce reportage a été réalisé dans le Parc national suisse à la fin de l’été. Fin septembre, l’Office fédéral de l’environnement a approuvé la demande du canton des Grisons d’abattre la meute du Fuorn, dont il est question dans cet article, après deux attaques sur des bovins. Les jeunes nés en 2024 pouvaient être abattus jusqu’à fin octobre, leurs parents après ce délai, mais uniquement hors du parc. Jusqu'à début novembre, un animal avait été tué. Au moment de mettre notre magazine sous presse, nous ignorons combien des 17 loups du Parc national suisse sont encore en vie. Selon Pia Anderwald, la chercheuse qui travaille sur place, il est toutefois prévisible que tôt ou tard une nouvelle meute se forme dans la région. Les scientifiques pourront alors peut-être tout de même étudier les changements à long terme avec et sans les loups.
Les mains protégées par des gants de laboratoire, Michael Prinz dépose la crotte dans un sachet en plastique qu’il glisse ensuite dans son sac à dos. L’échantillon sera analysé au microscope plus tard. Grâce à une analyse d’ADN, les scientifiques tenteront d’identifier le loup. Les analyses révéleront également son menu des derniers jours. Le Parc national, dans le canton des Grisons, a longtemps attendu l’arrivée des loups. Une femelle avait bien commencé à rôder dans la région fin 2016, mais elle est restée solitaire. Il a donc fallu patienter jusqu’en 2022 pour qu’un couple s’installe et donne naissance à huit petits au printemps suivant. «Ces louveteaux étaient une première dans le parc et nous avons été ravis de les avoir», se souvient Pia Anderwald, biologiste et chercheuse dans le Parc national. Une nouvelle portée de six s’était ensuivie.
En meute, les loups influencent nettement plus leur territoire qu’un animal solitaire. «Nous savons, pour l’avoir vu dans d’autres écosystèmes, que les grands prédateurs modifient durablement les interactions entre les espèces animales», explique Pia Anderwald.
Par exemple dans le Parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, où les loups ont donné un coup de fouet à la biodiversité. Leur présence augmente l’offre alimentaire des charognards. De plus, les loups contrôlent la population de wapitis. La conséquence en est une réduction de l’érosion des plaines et le long des cours d’eau, ce qui favorise la diversité des écosystèmes.
Le renard ne doit pas devenir trop impertinent
Michael Prinz poursuit sa marche sur le chemin de randonnée, toujours en légère montée. Il traverse la forêt, puis un vallon rocheux. Quand il pleut ici, celui-ci se transforme en rivière impétueuse,. Avec ses foulées amples et son long bâton de marche, il se fond à merveille dans le paysage. On peine à croire qu'au quotidien il est banquier.
Sur une pierre plus grande qui borde le sentier, Michael Prinz trouve une autre trace de crotte, nettement plus petite. «C’est celle d’un renard. Ces animaux aiment marquer leur territoire en laissant leurs déjections à des emplacements légèrement surélevés.» Après avoir aussi glissé cet échantillon dans son sac à dos, il documente sa trouvaille sur papier, coordonnées GPS à l’appui.
Aujourd’hui, sa randonnée fait partie du monitoring du renard: trois fois par été, des chercheuses et des chercheurs arpentent tous les chemins de randonnée du parc pour prélever des traces d’excréments du goupil. Ils déterminent ainsi les milieux naturels que ces petits carnassiers choisissent comme espaces de vie dans ce site de 170 kilomètres carrés. «Ces dernières années, nous avons observé qu’ils avaient utilisé pratiquement tout le Parc national, les surfaces ouvertes autant que les forêts», constate Pia Anderwald. L’interaction entre renard et loup n’en est que plus intéressante.
La biologiste voit deux influences possibles. D’une part, un loup peut tout à fait représenter un danger pour un renard. «Le renard n’est certes pas une proie typique du loup, mais s’il devient trop effronté et tente de lui voler une proie, cela peut rapidement changer.» D’autre part, elle s'attend à ce que les prédateurs indigènes profitent du loup. Il ressort en effet des analyses de déjections de ces dernières années que les renards du Parc national ne se nourrissent pas seulement de petits mammifères, d’insectes et de baies, mais aussi de charognes de cerfs et de chamois. «Grâce au loup, ils ont probablement davantage de restes de proies à disposition. Ainsi, leur offre en nourriture augmente.»
La meute devrait en outre avoir des effets indirects sur les populations de petits mammifères comme les souris, suppose Pia Anderwald. Tandis que son assistant Michael Prinz arpente le sentier, elle se lance dans l’escalade d’un talus boisé pour rejoindre l’une des cinq surfaces de capture du parc. C’est une vraie corvée, car une forêt intacte contient beaucoup de bois mort. La biologiste doit grimper sur les branches tombées à terre et se faufiler sous les arbres couchés. Elle consulte son GPS et confirme: «C’est bien ici.»
Elle sort l’un des pièges de son sac à dos, une construction tubulaire en métal, équipée d’un mécanisme de fermeture raffiné: un rail minuscule sur lequel les souris doivent marcher pour aller grignoter de la nourriture au fond de ce dispositif.
Les souris courent sur l'encre
Pia Anderwald place un peu de paille et une poignée d’aliments pour cochon d’Inde dans le piège avant de le poser sur le sol de la forêt, sous une branche couverte de mousse. Les pièges ne seront activés que dans cinq jours, pour deux nuits, car les souris doivent d'abord s'y habituer. Les scientifiques veulent ainsi s'assurer qu'un échantillon aussi représentatif que possible des petits mammifères vivant ici tombe dans leurs pièges. Une fois ceux-ci activés, ils sont contrôlés toutes les huit à dix heures. Les petites bêtes sont enregistrées puis libérées. Cette méthode permet de déterminer leur nombre périodiquement.
A 16 autres emplacements, à 90 mètres chacun de la surface de capture, les chercheuses ont placé des tunnels à empreintes. Ils sont longs d’un mètre environ, étroits et en bois. A l’intérieur, les souris et d’autres petites bêtes marchent sur du feutre imprégné d’encre spéciale. Les animaux laissent ainsi des empreintes de pattes sur des bandes de papier, ce qui permet de relever la diversité des espèces indigènes. «Nous pouvons partir du principe que la plupart des petits mammifères utilisent le tunnel, car ils apprécient de pouvoir se déplacer à l’abri des prédateurs», explique Pia Anderwald. «Il ne nous reste plus que 49 autres pièges à installer», lance-t-elle au moment de se remettre en route pour rejoindre le prochain l’emplacement.
Pour elle et son équipe de huit personnes, l’été est particulièrement éprouvant. Les journées de travail sur le terrain sont longues. Cet été et cet automne, la biologiste a testé une méthode de monitoring automatisé, avec laquelle les animaux sont enregistrés par des caméras. Mais elle ne sait pas encore si elle est aussi fiable que les tunnels à empreintes pour identifier les espèces.
Plus de loups, moins de cerfs, plus de souris
Le travail de terrain est toutefois payant dans la mesure où ce monitoring à long terme permet aux scientifiques de savoir quels petits mammifères vivent dans les lieux étudiés et combien ils sont. Les scientifiques sont désormais capables de percevoir les variations annuelles des populations. Les espèces de la forêt, notamment le campagnol roussâtre, le mulot alpestre, la musaraigne et le lérot, sont bien représentées dans le parc. «Cependant, nous n’avons pas encore pu démontrer la présence d’espèces champêtres, comme le campagnol des champs, regrette Pia Anderwald.
C’est probablement lié aux cerfs, qui broutent les prairies à ras.» Cette tonte radicale prive les petits mammifères d’habitat, car ils ont besoin de pouvoir se cacher. «Avec une meute de loups, la situation devrait toutefois changer», estime la biologiste. Elle suppose que les cerfs iront moins souvent manger dans le même pré, et que l’herbe y sera moins courte.
Le personnel du parc a déjà relevé des indices. L’herbe de certaines prairies était cette année plus haute que d’habitude. «Mais la météo a été particulièrement favorable à la croissance des plantes, relativise Pia Anderwald. Nous devons pouvoir observer l’évolution sur plusieurs années pour évaluer les effets de manière fiable.» Il est toutefois assez probable que les loups influencent indirectement l’implantation de nouvelles espèces.