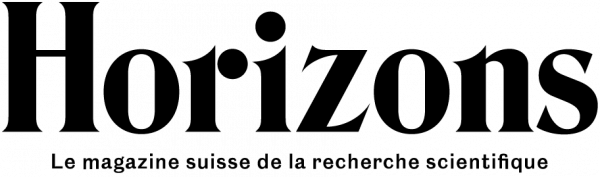Dossier: À la recherche de la paix
«Il n’y a pas d’attitude absolue concernant la recherche sur l’armement qui ne soit problématique»
Les hautes écoles doivent-elles aussi mener des recherches militaires? Nadia Mazouz, éthicienne à l’ETH Zurich, ne répond pas à la question, mais en appelle à un débat nuancé sur la science, la guerre et la paix.

«Ce qui m’importe, c’est de montrer les nuances.» La philosophe Nadia Mazouz parle de guerres justes, de pacifisme absolu et de pacifisme de principe. | Photo: Salvatore Vinci
Nadia Mazouz, si on vous avait demandé en 1939 d'aider à la mise au point de la bombe atomique contre les nazis, auriez-vous participé?
(Elle réfléchit longuement) Vous posez une question générale sur la justice de la guerre – juste au sens de moralement justifié, pas au sens moderne du fair-play entre individus. La réponse est compliquée et a plusieurs niveaux. Le fait que Françaises et Polonais se soient défendus contre les nazis était acceptable, même pour la plupart des pacifistes. Or, ce n’est pas parce qu’une guerre est justifiée que toutes les actions menées durant cette guerre le sont d’emblée. Rétrospectivement, il faut dire que le développement de la bombe atomique n’était pas justifiable. Il s’agissait de devancer les nazis qui étaient loin d’avoir développé la leur. Finalement, la bombe a servi à tenir les communistes en respect.
Les chercheurs impliqués le savaient-ils?
Quand, en 1939, Albert Einstein, un pacifiste, a écrit au président américain Franklin Roosevelt pour lui demander de développer la bombe atomique, il l’ignorait, bien sûr. Mais la question de savoir si Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet Manhattan, en avait connaissance et, si oui, depuis quand exactement, fait l’objet de controverses. Cela montre aussi que les jugements moraux dépendent de reconstructions historiques complexes, elles-mêmes incertaines.
De la physique à l’éthique
Nadia Mazouz (54 ans) est professeure de philosophie pratique à l’ETH Zurich. Après avoir étudié la physique à la TU de Berlin et obtenu son doctorat sur les systèmes électrochimiques à l’Institut Fritz-Haber de la société Max-Planck. Ensuite, elle a fait un second doctorat sur la justice et le bien à l’Université de Stuttgart. Après plusieurs étapes intermédiaires, dont un poste de professeure à l'Université de Marburg, elle est revenue à l’ETH Zurich en 2022 et a obtenu son habilitation sur la morale de la guerre et de la paix.
La réponse militaire de l’Ukraine à l’invasion russe est-elle moralement justifiée?
La guerre en Ukraine a montré à de nombreuses personnes qu’elles n’étaient pas des pacifistes absolues. Mais il existe aussi une version du pacifisme qui considère les guerres comme mauvaises par principe, mais qui connaît des exceptions. Un point central est par exemple la défense militaire contre les opérations visant à détruire les personnes attaquées. Or, les pacifistes par principe ne considèrent pas les guerres pour la défense de territoires ou de la souveraineté politique comme moralement acceptables. Pour de tels pacifistes, il est donc décisif de savoir si la Russie mène une guerre génocidaire ou s’il s’agit uniquement de s’approprier un territoire. Dès lors, la résistance militaire ne serait pas justifiée. Seule la résistance civile le serait.
Un non-pacifiste est-il automatiquement belliciste?
Non, il y a aussi des positions alternatives, à commencer par celle de la guerre juste, à certaines conditions: il faut avant tout une raison juste, pour l’essentiel donnée par la défense du territoire et de la souveraineté politique des communautés, ainsi que par la défense des droits humains fondamentaux. Pensez au Rwanda, où on aurait pu, avec peu de moyens militaires, empêcher un terrible génocide. Il existe encore bien d’autres critères. Il reste essentiel que l’objectif de la guerre soit la paix. Les pacifistes par principe et les partisans de la guerre équitable s’accordent sur ce point.
Quelle est votre position?
Le rôle d’une philosophe n’est pas d’imposer aux autres une opinion sur ces questions difficiles. Ce qui m’importe, c’est de montrer les nuances.
Vous avez certainement un avis sur l’Ukraine.
Oui, bien sûr. D’après mon appréciation politique, il est justifié que les Ukrainiennes se défendent militairement, même sans menace de guerre d’extermination. Simultanément, il est central de mettre l’accent sur l’évolution et la protection des institutions qui peuvent prévenir les guerres, en particulier les organisations multilatérales et internationales.
Votre position est-elle le résultat de réflexions philosophiques?
Nous, les philosophes, réfléchissons depuis des milliers d’années à la question de guerres justes. Une approche est guidée par la théorie et se demande par exemple si on peut fonder un avis sur les droits inaliénables des personnes ou des Etats. Ou sur une thèse qui se concentre sur les conséquences des actes. Aucune des deux ne permet d'aboutir à une position claire et sans contradictions. L’éthique appliquée, qui se base sur des jugements concrets de citoyennes et vient de la médecine, cherche une échappatoire. Elle travaille avec des études de cas pour parvenir à des jugements mûrement réfléchis. J'examine les tentatives de justification de la guerre juste.
Le Fonds national suisse se concentre sur la recherche civile. La Commission européenne estime quant à elle qu’il est de sa responsabilité de promouvoir la capacité de défense. Qu’est-ce qui est juste?
S’il peut y avoir des guerres défensives moralement justifiées, il est en principe aussi juste de faire de la recherche sur les moyens militaires. En particulier à une époque où il faut partir du principe que l’ordre international est imparfait, et où on ne peut empêcher efficacement les guerres d’agression. Mais cela ne signifie pas automatiquement que c'est aux universités de s’en charger. D’autres institutions peuvent le faire. Et même si c’était le cas, cela ne clarifierait pas la nature exacte de la recherche à mener dans les universités.
Qui devrait être autorisé à faire de la recherche sur l’armement?
Le mandat des universités est de servir la société. En échange, elles bénéficient de la plus grande liberté de recherche possible. Mais quand le sujet en est la guerre, les limites de cette liberté sont controversées. Là encore, même les pacifistes par principe peuvent être opposés à une interprétation trop restrictive d’une clause civile. Ainsi, la protection contre les catastrophes est généralement reconnue, même si, dans un certain sens, elle constitue aussi une recherche sur la guerre. Selon moi, le point essentiel est que les universités peuvent et doivent s’entendre sur le type de recherche qu’elles souhaitent mener, y compris la recherche ambivalente.
Mais les résultats de la recherche civile peuvent aussi servir des desseins militaires.
Oui, il s’agit alors de recherche à double usage. Même la recherche fondamentale peut avoir des conséquences imprévues. Qui aurait imaginé que des jouets tels les drones seraient utilisés un jour en Ukraine pour lancer des grenades dans des tranchées? On pourrait donc argumenter, à l'extrême, qu’une clause civile empêche toute recherche. Toutefois, même s’il y a beaucoup de zones grises, il y a aussi du blanc et du noir. Malgré de grandes incertitudes et ambivalences, il existe des recherches moralement acceptables et d’autres condamnables. La controverse porte sur la question de savoir laquelle est laquelle. Il n'existe pas d'attidue absolue qui génère des résultats non problématiques. Même une clause civile doit toujours être réexaminée afin de déterminer précisément ce qui doit être autorisé et ce qui doit être interdit.
Quel serait le cadre idéal pour mener les discussions sur la recherche militaire?
Mon expérience m’a montré que les scientifiques se posent beaucoup de questions sans savoir que faire des résultats de leurs réflexions. Certaines personnes sont dépassées par la complexité de ces questions éthiques. Mais par le passé, nous sommes parvenus, en tant que société, à mettre en place des instances pour clarifier d’autres questions éthiques. Pour la recherche avec des animaux, il existe des commissions pour la discussion interdisciplinaire sur les limites à fixer. A l’ETH Zurich, nous mettons en place un centre d’éthique où nous aborderons aussi la recherche militaire. Dans l’ensemble, il y a trop peu de théories à ce sujet. Et il en faut pour que la société puisse y réfléchir de façon plus complexe. Le thème du dossier de votre magazine est déjà une première pierre à l’édifice.