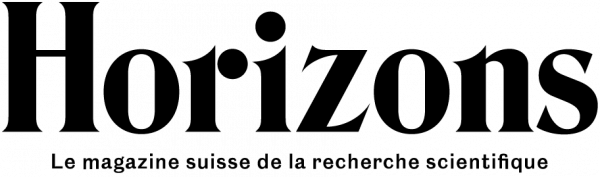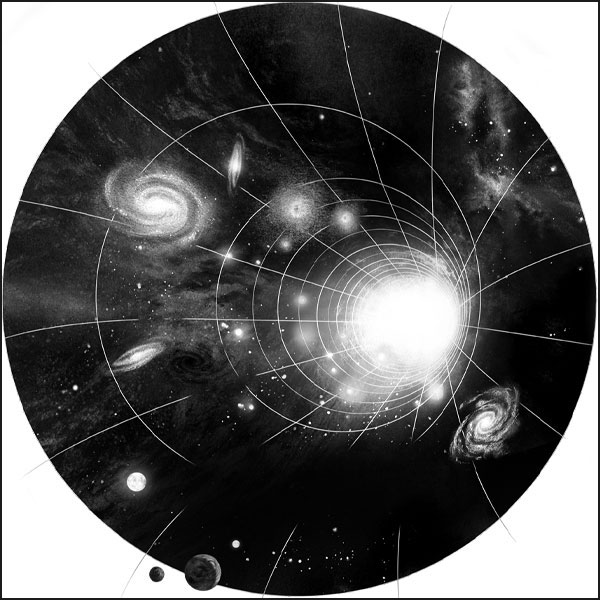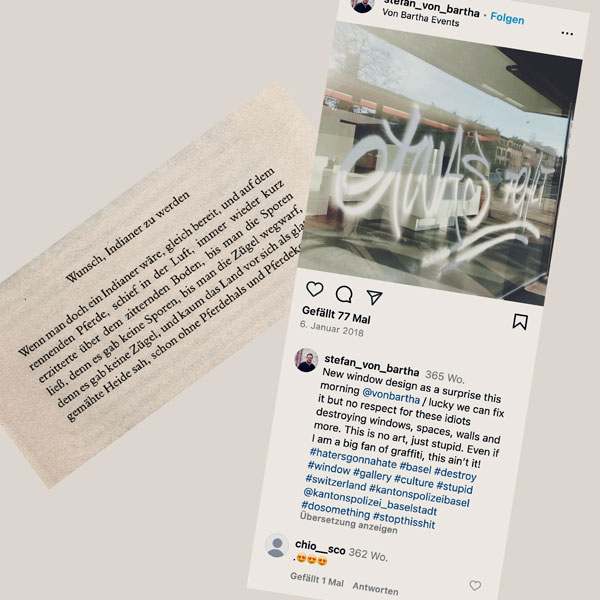SCIENTIFIQUES RÉFUGIÉS
Echouées avec le savoir dans les bagages
De nombreux scientifiques doivent fuir leur pays à cause de la guerre ou de mauvais traitements. Certaines peuvent poursuivre leur travail en Suisse. Cinq d’entre eux nous racontent leur histoire.

Najia Sherzay | Photo: Flavio Leone
«Je voulais aussi être une source d’inspiration et encourager les jeunes filles à étudier.»
«En 2021, les portes de l’Université de Kaboul se sont tout d’un coup fermées aux femmes avec l’arrivée au pouvoir des talibans. J’étais alors à la fois doctorante à distance en Malaisie et enseignante en biochimie à Kaboul. Je n’ai pas hésité longtemps: ma priorité était de poursuivre ma formation, même s’il fallait pour cela quitter mon pays. Une amie m’a parlé du programme Scholars at Risk. Mon dossier a été accepté en seulement deux jours, mais j’ai mis un an et demi à réussir à quitter l’Afghanistan avec ma famille.
Aujourd’hui, je suis accueillie en tant que chercheuse à l’EPFL. Je rattrape le temps perdu afin de terminer mon doctorat à distance et je me forme en parallèle aux techniques de mon nouveau laboratoire, qui ne me sont pas familières.
J’ai été bien accueillie par le réseau Scholars at Risk et par l’EPFL. Mon mari est lui aussi chercheur, et il est soutenu administrativement, par exemple pour obtenir un permis de séjour afin d’être en mesure de travailler. Nous avons deux enfants de $ et % ans qui sont scolarisés et bien accompagnés. Globalement, nous nous sentons bien en Suisse et je suis heureuse de pouvoir poursuivre mes recherches.
Pourtant, j’ai perdu un aspect important de ma motivation. A l’Université de Kaboul, j’étais active dans la défense du droit des femmes à l’éducation. Dans mon pays, il y a un immense travail de sensibilisation à faire. Ma position me permettait de faire remonter certains problèmes de discrimination ou de harcèlement auprès des autorités. Et au-delà de ma propre carrière, je voulais aussi être une source d’inspiration et encourager les jeunes filles à étudier. Ce n’est désormais plus possible: des hommes armés leur refusent l’accès à l’éducation. Ce faisant, ce qui est pire, ils leur interdisent tout espoir et beaucoup d’entre elles sont découragées. Je fais mon possible à distance, par exemple en informant à mon tour les femmes sur la possibilité d’obtenir des bourses pour partir à l’étranger.» ef

Emirhan Darcan | Photo: Flavio Leone
«Soudain, j’ai dû décider: dois-je faire quelque chose d’illégal en m’enfuyant?»
«J’ai des sentiments doux-amers quand je pense à ma fuite. Je viens d’Istanbul et j’ai une culture européenne. Pour moi, la Suisse a toujours été synonyme de liberté, de sécurité et de droits humains. Mon nouveau foyer à Berne me remplit donc de bonheur. Mon épouse, mes trois filles et moi avons toutefois traversé une période difficile. Depuis la tentative de putsch en 2016, la liberté d’expression n’a cessé d’être réduite en Turquie. Un académicien qui tient à sa liberté a intérêt à ne pas parler de sujets tabous. A Ankara, j’étais en danger à cause de mes projets de recherche sur la prévention de l’extrémisme ou de mon engagement pour les droits des femmes et des enfants. L’Etat me surveillait. Au final, je risquais une peine allant jusqu’à 15 ans de prison. Avant, j’étais un homme normal avec une carrière et une famille. Soudain, j’ai dû décider: dois-je faire quelque chose d’illégal en m’enfuyant? Une décision très difficile à prendre.
Tous les universitaires accusés de propagande terroriste, comme moi, se voient retirer leur passeport ou Interpol s’est vu notifier la disparition de ce document. Comme on avait de plus bloqué mes comptes, il m’a été très difficile de fuir vers la Grèce puis la Suisse. J’ai en partie fait de l’auto-stop et n’avais pas d’argent pour accéder à internet. Par chance, j’ai ensuite pu faire venir ma famille. Pendant trois ans, nous avons vécu dans huit centres d’accueil de réfugiés différents, à cinq dans une pièce de 20 mètres carrés, même durant la pandémie. C’est le temps qu’il a fallu pour que j’obtienne un poste de recherche temporaire grâce au programme Scholars at Risk. Mon projet actuel porte sur les détenus turcs dans l’exécution des peines en Suisse. J’étudie comment ils peuvent se réinsérer socialement dans leur pays d’origine après leur expulsion. Avec un appartement familial, grâce aux cours d’allemand, aux adhésions à plusieurs associations et au soutien de mon institut et de Scholars at Risk, je me sens bien intégré ici.» kr

Akram Mohammed | Photo: Flavio Leone
«J’ai été emmené de force dans des lieux inconnus.»
«J’ai fait ma scolarité au Yémen mais j’ai suivi mon Bachelor et mon Master en enseignement de l’informatique en Arabie saoudite, car j’avais envie d’avoir une expérience à l’étranger. C’est pour la même raison que j’ai postulé en 2015 à une bourse d’excellence de la Confédération suisse que j’ai obtenue. Cela m’a permis de faire mon doctorat à l’Université de Genève dans le domaine des systèmes d’information. Pendant que je découvrais Genève, j’ai commencé à m’impliquer dans l’éducation et la défense des droits humains. J’ai participé plusieurs fois aux sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. J’ai notamment soulevé la problématique des violations commises par les parties impliquées dans le conflit yéménite.
En 2018, j’ai donné une formation sur les droits de l’homme à Taïz, dans mon pays, ce qui m’a valu d’être arrêté et emmené de force pendant quatre jours dans des lieux inconnus, puis libéré, mais contraint de signer un document qui m’empêchait de sortir du Yémen. Heureusement, mon père m’a aidé à quitter le pays par l’aéroport d’Aden, qui n’était pas sous le contrôle des autorités yéménites. Après cela, la police locale est venue plusieurs fois pour me chercher. Chez moi, je risque l’arrestation, la disparition, la torture et même la mort. En Suisse, j’ai terminé mon doctorat et obtenu l’asile politique. Ma femme et mes trois premiers enfants ont pu me rejoindre en 2021. Notre dernier enfant est même né ici. Tout se passe bien, ils sont scolarisés et apprennent le français – plus vite que moi! Aujourd’hui, j’ai 43 ans et je suis chercheur postdoc dans le domaine de la sécurité de l’internet des objets. Après? Je ne sais pas précisément, mais le réseau Scholars at Risk m’accompagne. J’ai l’intention de rester en Suisse, je m’y sens bien.» ef

Olha Marinich | Photo: Flavio Leone
«Je me sentais comme un animal qui ne luttait plus que pour sa survie.»
«Sur mon lieu de travail dans la région de Kiev, les fenêtres ont été brisées, nos ordinateurs, l’approvisionnement en eau et le chauffage ont été pillés ou détruits par l’armée russe. Il faisait un froid glacial et nous n’avions de l’électricité que quelques heures par jour. Dehors, on a trouvé des engins explosifs. Aujourd’hui encore, les sirènes retentissent presque chaque jour là-bas. Il était devenu impossible de me concentrer sur mon travail ou de mener une vie à peu près normale. Je me sentais comme un animal qui ne luttait plus que pour sa survie. Depuis l’été 2022, je poursuis en Suisse mes recherches sur l’entreposage des déchets radioactifs. En Ukraine, mon directeur scientifique m’avait conseillé de postuler pour une bourse Scholars at Risk. Concrètement, il s’agissait d’un poste au sein de la division Energie nucléaire et sûreté du PSI. J’ai été très contente d’être acceptée, d’abord pour un contrat d’un an qui depuis a été prolongé deux fois. Grâce à Scholars at Risk, j’ai pu emménager dès le premier jour dans un paisible appartement à la campagne. Je l’adore!
Toutefois, l’intégration n’est pas simple pour moi. Mes amis me manquent beaucoup. Nous nous rencontrons parfois pour un souper en vidéophonie – une maigre consolation. Par chance, de nombreuses personnes ici parlent anglais, aident volontiers et m’emmènent de temps à autre faire de l’escalade. J’apprends aussi l’allemand, mais je n’arrive pas bien à exprimer mes sentiments dans une langue étrangère. De plus, je suis introvertie. La plupart du temps, je préfère rester seule entre mes quatre murs. Je peine à mener une vie normale quand j’entends chaque jour des nouvelles sur les bombardements russes qui font tant de victimes civiles. Ce que j’apprécie cependant: mon travail ici valorise mon profil scientifique. Et je sais que je contribue à la sécurité du futur dépôt en couches profondes. Et pour la suite? J’espère pouvoir rester à long terme – pour autant que la société n’ait rien contre. Si on me considérait comme inutile, je ne pourrais pas vivre avec ça.» kr

Parwiz Mosamim | Photo: Flavio Leone
«En Afghanistan, j’aurais sans doute été arrêté.»
«Après mon Bachelor en journalisme et communication de masse chez moi en Afghanistan, j’ai suivi un Master en administration publique en Indonésie et à l’ETH Zurich. Puis je suis rentré quelques mois dans ma ville pour voir ma famille. C’était au début de l’été 2021, au moment où les talibans prenaient le pouvoir. La situation est vite devenue chaotique. J’avais déjà été accepté pour un doctorat à l’Université de Lugano, alors je suis parti assez vite. En restant dans mon pays, je n’aurais de toute façon pas pu travailler. Pire, j’aurais sans doute été arrêté et peutêtre emprisonné, vu mon passé de journaliste parfois critique envers les talibans.
J’avais envie d’étudier à l’étranger pour bénéficier d’un enseignement de qualité, gagner en expérience et découvrir une autre culture. J’avais un financement pour les deux premières années de doctorat, et j’ai été soutenu par le programme Scholars at Risk pour la troisième. Ce genre de programme est une aide inestimable. Cela m’a ouvert des portes. Et je ne suis pas un exemple unique: il existe beaucoup de contraintes pour étudier en Afghanistan, mais il y a toute une génération déjà formée qui pourrait poursuivre ses études dans les pays voisins à condition de recevoir un soutien financier. Dans le cadre de mon doctorat, je travaille sur la représentation des femmes afghanes dans l’administration publique. Je m’inspire évidemment de ce qui se passe dans mon pays. Je veux montrer qu’il est important de donner une voix aux femmes. Par la suite, je m’imagine continuer mes recherches ou rejoindre une organisation internationale où je pourrai, j’espère, être utile à mon pays de près ou de loin. En attendant, il me reste un an et demi de doctorat et je profite de la Suisse, de sa nature et de sa gastronomie. Je suis très bien encadré à l’USI et je me sens bien intégré. J’aide à mon tour mes compatriotes à s’intégrer et je fais découvrir la culture afghane à mes collègues suisses.» ef