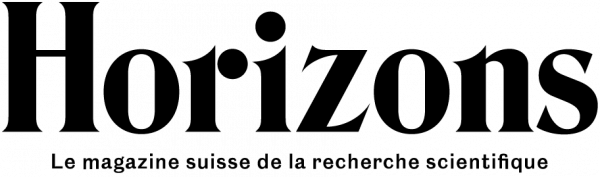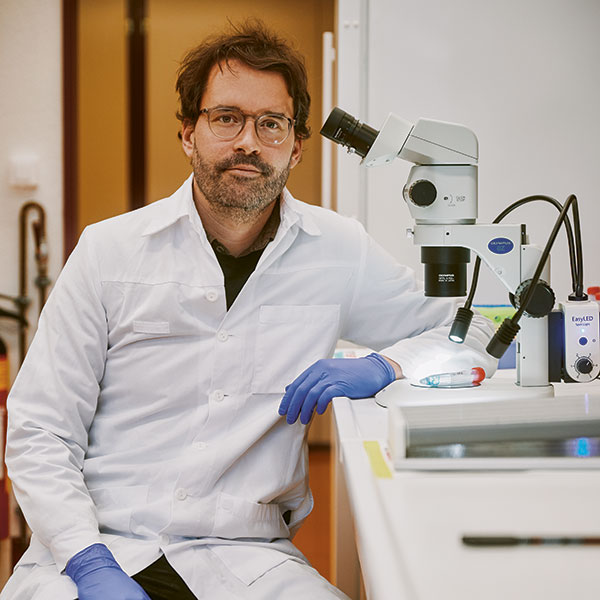ÉVOLUTION
La mouche qui a conquis le monde
Qu’il fasse chaud ou froid, sec ou humide: la mouche du vinaigre se sent bien presque partout. Un projet commun européen étudie comment l’évolution lui permet de s’adapter à de nouveaux biotopes.

Chaque mouche est différente. Une variante du gène de la paresse leur donne un avantage lors d’hivers rudes. | Photo: IRD/Vectopole Sud/Patrick Landmann/Science Photo Library
«De la banane, de la levure et peut-être une gorgée de bière», voilà la mixture idéale pour attirer les mouches du vinaigre dans une bouteille en PET décrite par Martin Kapun. Equipés de ces simples pièges, des biologistes ont parcouru l’Europe durant l’été 2014 pour collecter des échantillons en vue d’un projet de recherche commun. L’objectif était de découvrir comment une espèce se propage et comment elle parvient à s’adapter à des conditions climatiques très différentes.
La mouche du vinaigre Drosophila melanogaster, surtout connue comme une hôte importune dans la cuisine, constitue un objet d’étude idéal pour répondre à ces questions. C’est un organisme modèle bien connu de la recherche biologique et l’histoire de ses migrations est passionnante: originaire d’Afrique, elle a commencé à se propager en Europe et en Asie, puis en Amérique et en Australie il y a environ 10000 ans. Elle a probablement suivi les humains, avec un décalage, lorsqu’ils ont commencé à cultiver des fruits.
«Le génome de cette mouche est comme un livre où est consignée l’histoire de ses migrations et de son évolution», explique Martin Kapun, biologiste de l’évolution à l’Université de Zurich et l’un des fondateurs et des coordinateurs du consortium Dros-EU (voir encadré: «Recherche en très large équipe»). Pour comprendre ce livre, les membres du groupe ont séquencé le génome de 48 populations européennes de mouches – du Portugal à l’Ukraine et de la Turquie à la Finlande. Ils ont ensuite cherché les différences génétiques qui montrent comment le génome des mouches s’est adapté et modifié.
Les analyses ont montré que les populations sont génétiquement différentes, surtout entre l’est et l’ouest de l’Europe. «Cette séparation en fonction de la longitude nous a surpris. En fait, nous l’aurions plutôt attendue entre le sud et le nord», dit Martin Kapun. Une comparaison avec les données climatiques a montré une corrélation claire entre l’importance des variations climatiques saisonnières et les différences génétiques. C’est pourquoi les chercheurs présument que les mouches se sont adaptées autant au climat océanique de l’ouest influencé par le Gulf Stream qu’au climat continental et à ses extrêmes dans l’est de l’Europe. Une autre explication des différences génétiques actuelles pourrait être le type de repeuplement après la dernière glaciation – à partir de deux refuges longtemps séparés sur la péninsule Ibérique et au Proche-Orient.
Mais lesquels de ces changements évolutifs se sont-ils produits dans le génome des drosophiles au cours de cette migration? Des analyses informatiques permettent de le déterminer: «Il y a déjà un bon moment qu’on dispose de la théorie en la matière», dit le généticien des populations et bio-informaticien Laurent Excoffier de l’Université de Berne. «Toutefois, compte tenu des grandes séries de données désormais disponibles, il faut l’affiner.» Le défi est ici de distinguer dans les différences génétiques celles qui viennent effectivement d’une adaptation due à la sélection naturelle et celles qui résultent d’un autre mécanisme – par exemple lorsqu’une toute petite population de faible diversité génétique s’installe dans un nouveau territoire.
Plus confortable durant l’hiver
En principe, une population présente plusieurs variantes d’un gène. Mais lorsqu’une de ces variantes procure soudain un avantage, par exemple pour survivre dans le froid, elle écarte progressivement les autres – il s’agit d’une sélection positive.
Au moyen de méthodes statistiques, Martin Kapun et son équipe ont identifié de nombreuses variantes issues d’une sélection positive. Une variante de ce qu’on peut appeler un gène de la paresse explique probablement que les mouches observent une pause hivernale dans la reproduction – une caractéristique qui ne jouait guère de rôle dans leur région d’origine, l’Afrique, mais qui s’avère essentielle pour la survie en Russie. Pour certains autres gènes identifiés, les chercheurs n’ont pas encore établi de lien clair avec les conditions climatiques. Des recherches supplémentaires seront nécessaires.
«Dans quelle mesure les espèces peuvent s’adapter à leur environnement soulève des questions passionnantes», estime Cleo Bertelsmeier, professeure d’écologie à l’Université de Lausanne. Elle-même étudie comment les espèces invasives réussissent à s’établir dans de nouveaux biotopes. «Nous ignorons encore par exemple si et à quelle vitesse les insectes amenés par le commerce des fruits peuvent s’adapter à un nouveau climat.» Le comprendre est pourtant très important.
Certains insectes peuvent détruire des récoltes entières, par exemple la mouche méditerranéenne des fruits qui vient également d’Afrique. Elle s’est propagée en Suisse au cours des dernières années et a déjà attaqué des pommiers de la région zurichoise. Les connaissances acquises sur l’évolution pourraient contribuer à une meilleure évaluation des risques liés à l’introduction de tels nuisibles et permettre de prendre les mesures adéquates. D’autres espèces d’insectes envahissantes pourraient aussi s’avérer dangereuses pour l’homme, en particulier le moustique tigre asiatique, qui peut transmettre la fièvre jaune. Cleo Bertelsmeier relève un autre point intéressant: «Une grande question encore sans réponse est de savoir ce qu’il adviendra de nos espèces indigènes si les températures augmentent subitement de 1 ou 2 degrés en raison du changement climatique.»
«Pour répondre à de telles questions, il est certainement préférable d’étudier l’évolution sur le terrain plutôt qu’en laboratoire», dit Laurent Excoffier. Les expériences en laboratoire ne sont pas représentatives parce qu’il peut y avoir des consanguinités et une adaptation aux conditions d’élevage en laboratoire. «Nous avons maintenant la possibilité d’examiner sur le terrain l’intégralité du génome de certaines populations et de constater précisément où a lieu l’évolution ainsi que les gènes et les métabolismes impliqués.»
Les données ne livrent pas des informations que sur l’évolution des mouches. Les chercheurs ont pu également séquencer leur microbiome, soit les bactéries, champignons et virus qu’elles portent. Là aussi, ils ont découvert dans les génomes des différences en corrélation avec le climat. Ils vont maintenant examiner si ces sous-locataires aident leurs hôtes à s’adapter à de nouveaux habitats.