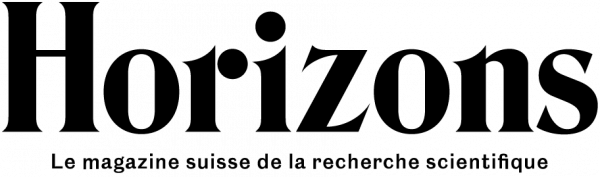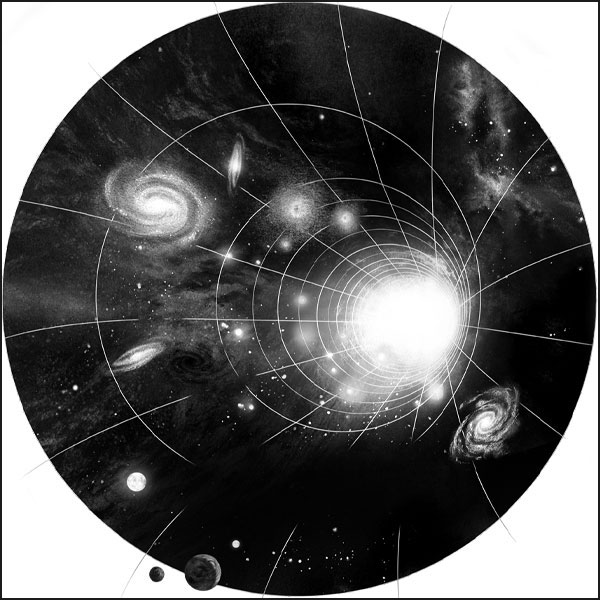La butineuse de science
Elle se voit comme une nomade de la recherche: la biologiste Gisou van der Goot a grandi sur quatre continents et marque aujourd’hui de son empreinte les sciences de la vie à l’EPFL. Rencontre avec une chercheuse enthousiaste qui ne se prend pas au sérieux.

Ce que Gisou van der Goot aime dans la biologie: les questionnements et l'incertitude. | Image: Valérie Chételat
«En science, il y a les chercheurs très focalisés qui poursuivent pendant des années un but donné. Et il y a ceux que j’appelle les pollinisateurs, qui passent plus volontiers d’un sujet à l’autre, s’amuse Gisou van der Goot. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie.» La professeure de l’EPFL dit d’ailleurs suivre son intuition, ce qui lui réussit. Elle a reçu des prix prestigieux pour ses recherches en biologie cellulaire et fait partie du cercle restreint des doyens de la haute école lausannoise.
Ingénieure de formation reconvertie en biologiste, cette femme enjouée se définit comme une nomade de la science. Elle connaît la portée du mot: néerlandaise d’origine, elle a grandi entre l’Iran, l’Egypte, l’Indonésie et les Etats-Unis, en déménageant pratiquement tous les deux ans, dans le sillage de son père, agroéconomiste à l’ONU. Scolarisée à l’école française, la «fana de mathématiques» se décide pour des études d’ingénieure à Paris. Diplôme en poche, elle écoute la petite voix qui lui souffle qu’elle risque de «regretter à 40 ans de ne pas avoir essayé la recherche». Elle réalise donc une thèse en biophysique moléculaire.
Le plaisir des crises
Mais son laboratoire parisien lui paraît «peu inspirant», et elle décide de faire un deuxième essai pour son postdoc au Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL), à Heidelberg. «J’y ai découvert ce qu’était la recherche. Cet institut est une véritable fourmilière de sciences où on peut très vite faire plein d’expériences. Je me suis rapidement sentie à ma place dans cet essaim.» Elle y rencontre son mari, actuellement professeur de biochimie à l’Université de Genève, et y trouve la confirmation que la biologie lui convient mieux que l’ingénierie. «Les ingénieurs cherchent à résoudre des problèmes relativement bien définis. Mais les biologistes, eux, vivent une sorte de crise existentielle permanente. On ne sait jamais si on se pose la bonne question. Angoissant? Pas le moins du monde! J’aime être dans cette quête et ce questionnement…»
Et sa quête depuis plusieurs décennies est celle de la cellule. «Cette unité biologique fondamentale est capable de compiler toute une série d’informations et de réagir vis-à-vis d’elles comme un mini-cerveau, ce qu’on ne comprend pas. Cela me fascine», vibre-t-elle. Les méandres de son «fleuve de la science» l’ont également amenée à se passionner pour la relation «hôte-pathogène»: elle s’intéresse notamment à plusieurs toxines bactériennes qui utilisent des protéines comme porte d’entrée du corps.
Contre les préjugés
Mais la société n’a pas toujours partagé son enthousiasme pour la recherche, raconte la doyenne de la Faculté des sciences de la vie à l’EPFL: «Ce n’est pas facile en Suisse d’être une mère qui fait carrière». Elle se souvient bien du jour où la mère d’une camarade de sa fille, à qui elle venait de se présenter, lui a répondu: «Mais je vous connais, vous êtes la maman qui n’est jamais là»! De telles critiques l’ont touchée: «On a beau se protéger, c’est dur», confie-t-elle. Et son fils de lui demander pourquoi elle n’était pas «comme les autres mamans» et qu’elle devait si souvent voyager.
«C’est là que j’ai découvert l’importance des récompenses», rigole-t-elle. En 2009, elle reçoit coup sur coup les Prix Leenards et Marcel Benoist. «Soudainement une instance supérieure – à savoir les médias, y compris locaux – ont déclaré que mon travail en valait la peine. Cela a changé ma vie privée, ainsi que le regard porté sur mon travail par mes enfants, leurs enseignants et les autres parents.»
Ses études d’ingénieure l’avaient habituée à faire partie de la minorité féminine. Néanmoins, elle dit n’avoir jamais autant ressenti les préjugés liés au genre que depuis son accession au décanat. Ils l’ont «frappée comme une gifle», notamment à ses débuts. «Dans les réunions, ceux qui ne me connaissaient pas pensaient que j’étais là pour prendre le procès-verbal… Je ne peux pas leur en vouloir puisque, d’un point de vue statistique, il y a tellement peu de femmes dans les directions.» Elle s’efforce d’encourager la présence des femmes et des parents au sein de la faculté, notamment en s’impliquant fortement dans du mentorat de jeunes chercheuses.
Elle se dit également préoccupée par le changement climatique, et vouloir lancer un appel à ses collègues afin de diminuer leurs voyages intercontinentaux: «Chacun devrait faire quelque chose pour diminuer son empreinte carbone» (voir «La recherche doit réduire ses émissions de CO2»).
La biologiste ne compte pas s’éterniser au décanat: «J’arrêterai après mon second mandat, lorsque j’aurai terminé les restructurations visant à professionnaliser certaines fonctions.» La nomade se dit désormais bien établie: «Je ne bougerai plus! Il y a un âge où il faut s’arrêter de déménager, car c’est le tissu social qui permet de vivre bien le plus longtemps possible. Les racines sont plus importantes quand on est âgé.» Une conviction qui l’a poussée à refuser des postes de direction dans de prestigieuses institutions à l’étranger: «J’ai immédiatement décliné. Ils doivent penser que je suis folle», sourit-elle.
Le goût du voyage n’a pourtant pas quitté cette amoureuse du Moyen-Orient, qui rêve notamment de visiter l’Afghanistan. Mais son travail et le temps des vacances lui suffisent. «Le milieu de la recherche est idéal car on rencontre plein de gens, on voyage, sans devoir bouger tout le temps. En Suisse, je peux vivre dans un village de 1000 habitants tout en faisant de la science de haut niveau. C’est un luxe.» Ou quand la nomade trouve l’équilibre – presque – parfait.