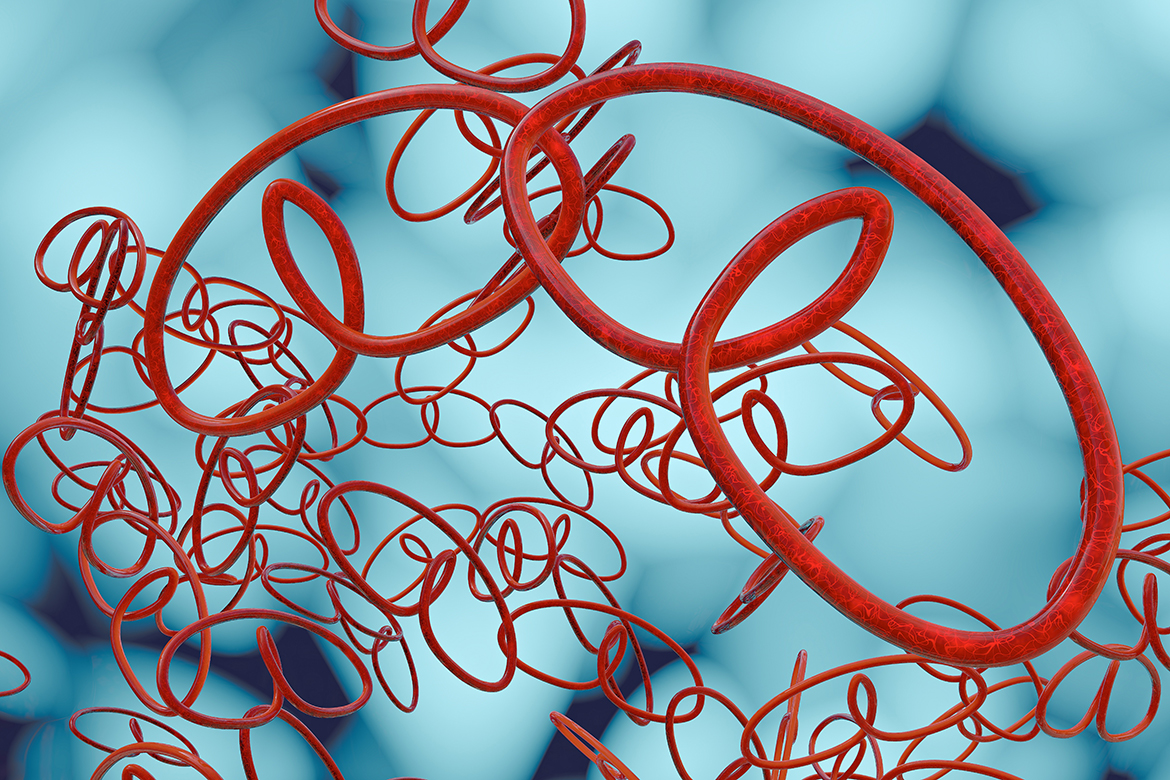L’ethnologue en blouse blanche
Pendant un an, Marie-Cécile Frieden a observé des services gynécologiques au Burkina Faso. La chercheuse veut comprendre comment le corps médical, les patientes et les proches vivent la prise en charge d’une maladie très fréquente: le cancer du col de l’utérus.

Salle de consultation gynécologique (en haut) au Centre hospitalier universitaire de Ouagadougou | Image: Marie-Cécile Frieden
«Tous les matins, je quittais mon quartier modeste de Ouagadougou et ses fréquentes coupures d’eau et d’électricité. Je montais sur ma moto pour près d’une heure de trajet dans un trafic parfois chaotique. A mon arrivée à l’hôpital, j’étais toujours frappée par les odeurs d’urine et de mort. Il fallait être solide. Je côtoyais quotidiennement des personnes qui souffraient et qu’on ne pouvait que peu soulager. Le cancer tue en Afrique davantage que le Sida, la tuberculose et le paludisme réunis, mais le Burkina Faso ne comptait en 2015 que quatre oncologues pour ses 18 millions d’habitants.
Des solutions improvisées
Ma thèse en ethnologie porte sur le cancer du col de l’utérus. Je cherche notamment à comprendre comment les protocoles officiels de prise en charge de la maladie issus d’institutions nationales ou internationales se traduisent concrètement sur le terrain. Je me suis principalement concentrée sur le Centre hospitalier universitaire de Ouagadougou. J’étais assimilée au personnel soignant du service gynécologique et portais une blouse blanche. N’ayant aucune formation médicale, je rendais de petits services. Cela m’a permis de justifier ma présence dans cet environnement. Au total, j’ai assisté à plus de 400 consultations, observé les soins et mené de nombreux entretiens auprès des patients et du personnel.

Image: Marie-Cécile Frieden
Marie-Cécile Frieden mène un doctorat en ethnologie à l’Université de Neuchâtel. Entre sa licence et sa thèse, cette passionnée d’Afrique de l’Ouest a vécu trois ans au Burkina Faso. Elle y a mené des recherches sur la thématique des femmes et du virus VIH, et travaillé pour une OGM active dans la promotion de la santé par les plantes médicinales.
J’ai constaté que les équipes médicales se montrent en général très réceptives aux injonctions officielles et aux nouvelles techniques. Mais elles sont confrontées à de grandes difficultés en termes de formation et de moyens à disposition, ce qui peut donner lieu à du «bricolage».
Par exemple, les lésions précancéreuses prélevées lors de dépistages doivent être envoyées au laboratoire dans un récipient médical spécifique à usage unique. Comme c’est aux patientes de
l’acheter et qu’elles n’en ont généralement pas les moyens, le personnel réutilise des flacons de médicament à injecter. Ils les referment et les placent dans un gant en latex pour créer des conditions aussi stériles que possible. De leur côté, les patientes manifestent souvent de l’incompréhension face au cancer du col de l’utérus, pour elles une maladie méconnue. Dans 80% des cas, elles sont dépistées à un stade avancé du cancer, et il n’y a plus grand-chose à faire pour elles. Les médecins leur expliquent rarement la gravité de leur cas, mais en parlent à la personne qui les accompagne et lui laissent le choix de transmettre l’information ou non. Officiellement, ils craignent que la patiente renonce à se battre si elle se sait condamnée. Mais dans les faits, il n’y a souvent aucun traitement disponible.
Se forger une carapace
Le milieu médical africain a fait l’objet de plusieurs études dans les années 1990-2000, qui pointaient du doigt le personnel soignant pour des maltraitances envers les patients. J’ai eu l’occasion de constater que des comportements dénigrants sont une réalité, tant au niveau verbal que physique, mais qu’il s’agit surtout d’une forme d’autoprotection. Les équipes médicales vivent comme une forme de violence le fait de ne pouvoir soigner les patientes, par manque de moyens et de possibilités de dépistage précoce. Contre ces sentiments de frustration et de lassitude, ils se forgent
une carapace.

Centre hospitalier universitaire de Ouagadougou. Le personnel se dit frustré de n’être souvent pas en mesure de soigner les malades par manque de moyens. | Image: Marie-Cécile Frieden
Moi-même, j’ai parfois emprunté avec les patientes le ton autoritaire des équipes médicales. J’ai un peu honte quand j’y repense, mais il s’agissait en même temps d’une manière de trouver une place dans ce milieu, de me faire comprendre et accepter, à la fois comme personne et comme scientifique.
J’ai dû également admettre que je ne pouvais pas toujours être maître de mon environnement. Au contraire, c’est lui qui m’a placée dans ce grand puzzle. A l’origine, je pensais que cette recherche me donnerait un rôle de porte-parole pour ces patientes peu ou pas du tout prises en charge. Au final, je le suis plutôt devenue pour le personnel soignant. Une fois ma thèse terminée, je souhaiterais transmettre mes résultats aux médecins que j’ai côtoyés, aux institutions officielles et à diverses associations. J’espère ainsi favoriser une prise de conscience de la situation et encourager une réflexion sur quelques pratiques susceptibles d’être améliorées – malgré les contraintes du milieu.»
Propos recueillis par Martine Brocard