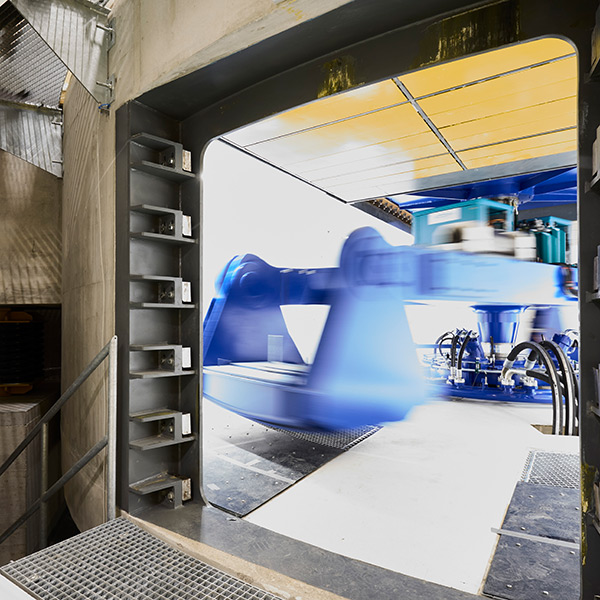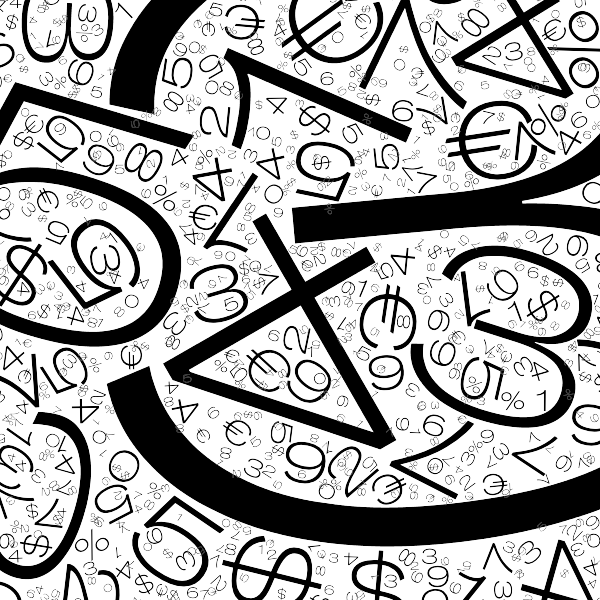Turquie: des recherches à haut risque
La situation politique tendue rend le travail des scientifiques de plus en plus difficile en Turquie. Des chercheurs étrangers racontent.

Photographie du procès de l’artiste aristocrate ottomane Aliye Berger, accusée d’avoir tiré sur une rivale amoureuse. Un siècle plus tard, étudier ce type de documents historiques – comme le fait Nataša Miškovic à l’Université de Bâle – s’avère une affaire délicate. | Photo: SIBA-Datenbank
L’anthropologue prend notre appel depuis les bords turcs de la mer Egée. Elle est arrivée quelques jours plus tôt dans le pays afin d’y étudier la situation politique: «Je veux savoir quels types de recherches sont encore possibles dans le pays», dit-elle. Pour ne pas mettre en danger sa personne et ses partenaires locaux ou risquer de compromettre ses travaux, elle restera anonyme, tout comme d’autres sources pour cet article.
Elle travaille en Turquie depuis plusieurs années. Elle n’est pas encore en mesure d’évaluer quelles activités pourront être menées. «Dans tous les cas, faire des recherches ici sera plus difficile», dit-elle.
Tout comme l’anthropologue, bon nombre des scientifiques européens qui se penchent sur la Turquie perçoivent la situation comme imprévisible et potentiellement menaçante. Ils sont confrontés à des complications importantes: ils ne reçoivent plus d’autorisation de recherche, ou seulement au prix d’immenses efforts, l’accès aux archives devient difficile et les partenaires sur place se montrent plus prudents. Ils peinent à évaluer la forme prise par la surveillance étatique. L’anthropologue se fait surtout des soucis pour ses collègues locaux: le pire qu’elle puisse craindre est une expulsion et une interdiction d’entrée sur le territoire. Son partenaire dans le pays et la doctorante turque, eux, risquent des conséquences autrement plus graves.
La forte pression exercée sur le monde académique turc est largement relayée par les médias européens. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: depuis la tentative de putsch de l’été 2016, l’Etat turc a licencié plus de 4800 chercheurs et ouvert une procédure pénale contre plus de 100 d’entre eux, selon des chiffres de l’Université de Lund. Début juin, l’organisation américaine Scholars at Risk a publié un nouveau rapport sur la Turquie. Ses auteurs soulignent que les poursuites contre les scientifiques ont atteint une «ampleur sans précédent»: fermeture d’universités, licenciements, emprisonnements et interdictions de voyager. Des milliers sont touchés par la répression. Et les persécutions continuent.
L’autocensure comme protection
Le climat politique se répercute sur le travail des chercheurs étrangers sur place, mais aussi dans les hautes écoles où leurs résultats sont analysés et diffusés. «Nous réfléchissons soigneusement à ce que nous pouvons publier ou non», dit un professeur en sciences sociales qui travaille sur la Turquie depuis plus de trente ans. Par chance, son équipe a terminé la récolte de données de terrain avant la tentative de putsch de 2016: «Ces recherches, nous ne serions plus en mesure de les mener aujourd’hui.»
Ses collaborateurs, dont une personne de nationalité turque, ont quitté le pays il y a plus d’un an. Ils analysent actuellement les données en vue d’une première publication. La recherche porte sur la délicate question des rapports entre la société turque et l’Etat. «Nous devons être très prudents et ne pouvons pas écrire tout ce que nous aimerions.» La priorité est la protection des collaborateurs et des sources sur place, des employés d’ONG et des politiciens d’opposition.
D’un côté, les scientifiques veulent honorer l’exigence de publier tous les résultats pertinents; de l’autre, ils doivent gérer la peur diffuse de la répression. Les craintes sont attisées par les arrestations et les licenciements dans diverses organisations et universités. Ce dilemme touche aussi Nataša Miškovic, professeure boursière FNS à l’Université de Bâle. Son projet de longue durée sur la genèse de la République turque et la vie quotidienne à Istanbul et Ankara dans les années 1920 et 1930 passe notamment par l’analyse de photographies de presse des grands quotidiens Cumhuriyet et Aksam.
La recherche est terminée et Nataša Miškovic prépare une exposition qui devrait être présentée également en Turquie. Ce projet demande une grande circonspection: «Nous menons d’intenses discussions pour décider ce qui sera montré et où.» Des compromis ont été faits pour ne pas perdre des partenaires. La prudence est surtout de mise lorsqu’il est question de violence d’Etat. «Comme beaucoup d’autres chercheurs, nous travaillons en gardant toujours un pied sur le frein.»
Un sentiment de menace diffuse s’insinue sans cesse dans les discussions avec les scientifiques. Mais cette situation imprévisible ne leur ôte pas la volonté de poursuivre leur travail. «Nous ne pouvons pas quitter tous les pays qui ne veulent pas que l’on étudie chez eux», souligne l’anthropologue au téléphone. Elle doit raccrocher. Dans une demi-heure, elle rencontrera les employés d’une organisation locale, toujours accompagnée par ce sentiment d’inquiétude latent.
3 octobre 2005 Début des négociations d’adhésion entre la Turquie et l’Union européenne.
15 juillet 2016 Tentative de putsch. Le gouvernement accuse le prédicateur Fethullah Gülen d’en être l’instigateur. 21 juillet 2016 Etat d’urgence: restriction des droits fondamentaux et de rassemblement.
4 novembre 2016 Publication de chiffres: 11 000 fonctionnaires, juges, policiers, soldats et scientifiques ont été suspendus ou licenciés à cause de liens présumés avec le réseau de Fethullah Gülen. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées et 170 médias fermés.
8 février 2017 Nouvelle vague de licenciements: 4500 fonctionnaires, dont 330 employés de hautes écoles, sont renvoyés.
16 avril 2017 Le référendum controversé sur la constitution est accepté par 51,4% des voix 18 avril 2017 Le gouvernement prolonge l’état d’urgence de trois mois.
30 avril 2017 La Turquie bloque l’accès à Wikipedia. 1er août 2017 Début d’un procès de masse de 500 putschistes.
Installé à Bâle, le journaliste indépendant Simon Jäggi écrit notamment pour la Tageswoche.