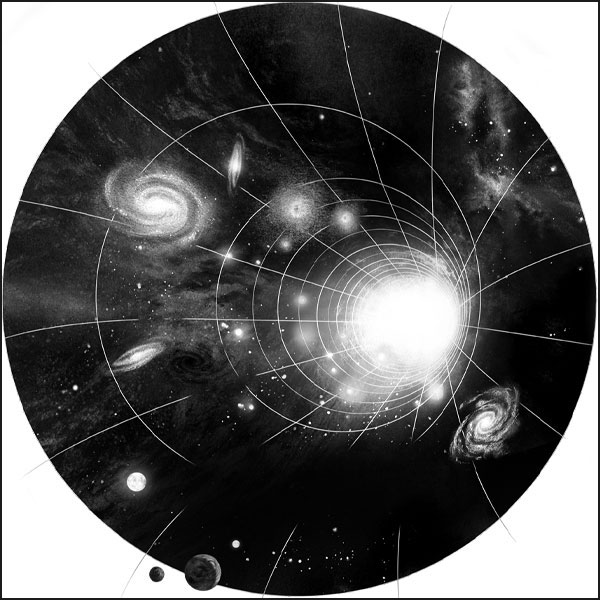Sprechen-vous English?
De plus en plus de cours universitaires suisses se donnent désormais en anglais. Certains le peçoivent comme un mal inévitable. D’autres appellent à embrasser un vrai plurilinguisme assumé.
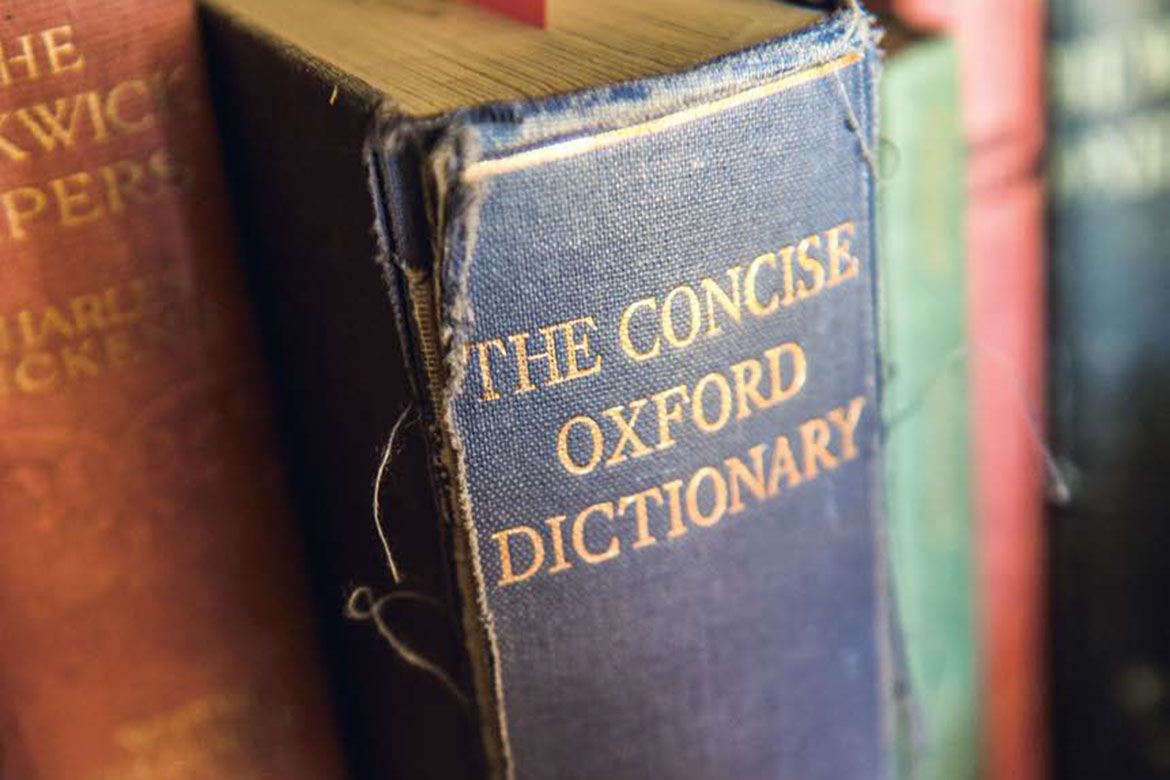
La question n’est pas d’être pour ou contre l’anglais, dit la linguiste Rita Franceschini, mais de maîtriser la langue qu’on utilise. | Photo: Valérie Chételat
Un professeur de psychologie allemand qui enseigne à l’Université de Genève en anglais; des cours d’histoire de l’art à l’Université de Zurich, annoncés se dérouler en allemand, mais où on entend plutôt la langue de Shakespeare. La globalisation de la recherche amène en Suisse une élite scientifique qui communique en anglais, même si ce n’est souvent pas sa langue maternelle. La tendance est à la hausse, confirment les hautes écoles de Bâle, Berne, Genève et Zurich interrogées par Horizons, même si les statistiques manquent à ce sujet.
«Pour ceux qui commencent leurs études, il s’agit d’un obstacle supplémentaire», remarque Josef Stocker, de l’Union des étudiants de Suisse (UNES). Il n’est certes pas insurmontable, poursuit l’étudiant en mathématiques; dans de nombreuses matières, l’usage de l’anglais s’avère même judicieux. Il dit clairement voir la nécessité de se faire comprendre dans un environnement international, mais souligne que la tendance se traduit pour de nombreux étudiants par du travail supplémentaire. «Les hautes écoles devraient faire preuve de transparence sur la proportion de cours donnés en anglais. Aujourd’hui, les règlements ne sont parfois pas respectés à cause du manque d’enseignants maîtrisant une langue nationale.» Il serait également bénéfique que les hautes écoles proposent une aide concrète pour améliorer le niveau d’anglais des étudiants.
Des règles peu claires et peu suivies
Les règlements et la politique linguistique des universités sont souvent vagues et varient fortement. Une directive de 2010 d’ETH Zurich souligne que l’allemand est en principe prévu pour l’enseignement en bachelor, mais que des cours peuvent être dispensés en anglais ou en français. A l’EPFL, le site Internet informe que le français domine en première année, mais qu’ensuite jusqu’à 50% des cours ont lieu en anglais. Les masters se déroulent dans l’une des deux langues, ou sont bilingues. A l’Université de Bâle, les enseignements de bachelor sont «majoritairement en allemand». Quant à l’Université de Zurich, les différentes facultés peuvent décider elles-mêmes ce qui leur convient.
De grandes différences existent entre les filières. Dans les sciences naturelles, les sciences de la vie et les sciences sociales, l’anglais est inévitable. C’est aussi de plus en plus souvent le cas en lettres. Les pessimistes craignent que le recours à une langue unique n’appauvrisse la science. Les optimistes considèrent qu’une lingua franca scientifique représente une opportunité pour communiquer de manière universelle.
«Sans l’anglais, ça ne marche pas, lance Gerd Folkers, président du Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) et professeur de chimie de l’ETH Zurich. Les étudiants doivent pouvoir lire les sources et les articles en langue originale.» Il soutient la revendication pour davantage de transparence au sujet des langues d’enseignement dans les universités suisses: «Les règles du jeu doivent être publiques.» Il réclame par ailleurs une approche réfléchie sur la question plutôt que des décisions fortuites. «L’enjeu consiste à trouver la langue qui corresponde le mieux au contenu.»
Gerd Folkers aborde une différence importante en science. De nombreux contenus sont décrits à l’aide d’une langue «théorique» relativement indépendante des constructions linguistiques, notamment dans les sciences très formalisées telles que les mathématiques. D’un autre côté, ces concepts sont communiqués et débattus dans la langue de l’enseignement – l’allemand, le français ou l’anglais. «En Suisse alémanique, donner un cours en anglais sur les effets biochimiques d’un nouvel antibiotique ne pose pas problème, car j’utilise une langue théorique. Mais l’allemand peut représenter un meilleur choix si l’on veut aborder leur utilisation dans l’élevage porcin et discuter des conséquences pour les humains. Car les faits complexes touchant à plusieurs disciplines s’organisent mieux dans le cerveau s’ils sont transmis dans notre langue maternelle.»
Le plurilinguisme comme projet
Gerd Folkers plaide pour une approche plus consciente du plurilinguisme. L’anglais s’est imposé comme consensus minimal. «Mais l’université est-elle vraiment un lieu où accepter le plus petit dénominateur commun?» A ses yeux, il serait plus coura geux d’améliorer les connaissances en anglais des étudiants en proposant des cours et des tutorats, tout en cultivant le plurilinguisme afin de stimuler le discours scientifique dans la langue maternelle. Un biologiste intervenant devant une assemblée communale sera-t-il en mesure d’expliquer de manière claire dans sa première langue un projet de protection de la nature s’il a suivi tout son cursus en anglais?
La professeure de linguistique Rita Franceschini va plus loin et défend une façon différente d’aborder la question: «Je souhaiterais un développement plus dynamique, un vrai plurilinguisme. Au lieu de considérer l’anglais comme un problème, les universités devraient planifier le plurilinguisme. Il n’est plus tenable de proposer des cours totalement unilingues. Les concepts devraient si possible être introduits en parallèle dans plusieurs idiomes.»
Les parcours linguistiques sont devenus plus variés avec la mobilité internationale. Rita Franceschini ne pense donc pas qu’à l’anglais. Un professeur né à Lugano, qui a grandi en Berlin et étudié à Londres sera, selon les circonstances, plus à l’aise pour argumenter en anglais, en allemand ou en italien.
«La langue permet de transmettre de nouveaux savoirs, poursuit Rita Franceschini. Mais comment aide-t-on les étudiants à se les approprier? Une possibilité est de le rattacher à des connaissances existantes. Les universités devraient mieux intégrer cette idée en tant que concept linguistique.»
Rita Franceschini enseigne à l’Université de Bolzano, dans le nord de l’Italie. L’établissement a mis en place un concept linguistique qui tient compte du contexte trilingue de la région, où l’on parle ladin (un idiome rétho-roman) ainsi que l’allemand et l’italien. Les professeurs sont encouragés financièrement à apprendre l’une de ces deux langues, au moins pour un usage quotidien. «Cette approche serait aussi souhaitable dans les universités suisses», estime-t-elle. Malgré nos quatre langues nationales, la réalité est néanmoins tout autre: seules quelques hautes écoles disposent d’un concept réglementant l’articulation des langues nationales et de l’anglais. L’une d’entre elles est l’Université de Genève. Et à la question de savoir si les professeurs étrangers doivent apprendre une langue nationale, la réponse est des plus fédérales: chaque université est libre d’en décider.
Pascale Hofmeier est rédactrice scientifique au FNS.