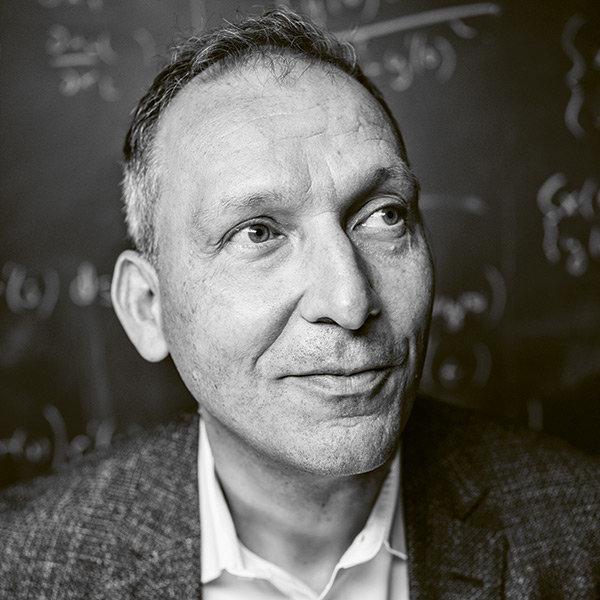«Je suis frustré»
Partager ses données est nécessaire et débouchera sur des travaux de meilleure qualité, souligne le président du Conseil de la recherche du FNS. Martin Vetterli connaît bien l’open science: en tant que chercheur, il la pratique depuis des années.

Photo: Valérie Chételat
En tant que chercheur, que signifie l’open science pour vous?
En tant que chercheur, que signifie l'open science pour vous?A la faculté d'informatique et communications de l'EPFL, nous avons pour tradition de mettre tous les articles publiés en ligne avec un accès gratuit. Nous fournissons par ailleurs l'ensemble des données et des codes sources. De cette manière, tous nos résultats sont susceptibles d'être reproduits par d'autres groupes de recherche.
Les chercheurs sont déjà noyés sous les articles. Comment garder une vue d'ensemble si tout est divulgué?
L'open science aura exactement l'effet inverse. Publier un article sur cette base signifie que toutes les données sont soigneusement documentées. Chaque étape ayant mené à un résultat est décrite afin de pouvoir être comprise par d'autres. Résultat: il y a moins d'articles publiés, et leur qualité s'améliore. La recherche gagne également en clarté.
Comment procédez-vous concrètement?
Nous publions toujours dans les revues traditionnelles, mais nous déposons toutes les données sur notre serveur en même temps que nous soumettons l'article. Dès qu'il est accepté, nous le mettons à disposition en libre accès.
Un chercheur ne devrait-il pas avoir le droit de garder pour lui ses recettes de laboratoire?
Certainement pas dans mon domaine. Mais c'est discutable aussi dans d'autres branches scientifiques. Il y a 350 ans, nous sommes sortis de l'alchimie pour entrer dans la chimie. Les alchimistes se contentaient d'affirmer qu'ils avaient fabriqué de l'or en suivant une méthode secrète. Il était impossible de vérifier leur affirmation de manière systématique. On pouvait y croire ou pas. Avec la chimie, les choses ont changé. Nous avons commencé à publier nos méthodes. Cela a marqué la naissance des sciences modernes. Si nous procédons différemment aujourd'hui, nous revenons à l'alchimie.
Seulement 40% des publications qui ont vu le jour suite à un financement du Fonds national suisse sont en libre accès. Cela vous satisfait-il en tant que président du FNS?
Non, je suis frustré. Nous sommes beaucoup trop lents. Aujourd'hui, le contribuable suisse paie trois fois. Une première fois pour la recherche, une deuxième pour l'abonnement à la revue spécialisée et une troisième fois pour les frais de publication en open access. Les maisons d'édition profitent à deux reprises. C'est tout à fait honteux. Nous ne pouvons le tolérer.
Que faites-vous là-contre?
Le FNS travaille avec Swissuniversities à l'élaboration d'une stratégie. Nous voulons que tous les articles soient librement accessibles, sans que nous devions encore nous acquitter d'une taxe. Nous espérons arriver à un accord avec les maisons d'édition pour que les chercheurs en Suisse obtiennent automatiquement le libre accès.
Comment voulez-vous y parvenir?
Si la place de recherche helvétique affiche une position unie, nous serons en mesure de dire aux maisons d'édition: soit vous passez un accord avec nous, soit notre communauté vous boycottera. C'est évidemment difficile. Mais les Pays-Bas y sont arrivés. Et cela a fonctionné.
Notre pays est-il prêt à franchir le pas?
Toute cette affaire est compliquée. Les divers acteurs de la place de recherche suisse ont des intérêts différents. Nous avons encore du mal à les coordonner.
Le FNS ne serait-il pas en mesure de forcer les chercheurs à ne publier leurs données que dans des revues open access?
Ce n'est pas si simple, car suivant les circonstances, cela pourrait avoir un impact négatif sur leurs carrières. Un chercheur doit publier dans la revue la plus en phase avec ses résultats. Notre objectif est aussi d'encourager les carrières des chercheurs, pas de les entraver.
Vous allez prendre la présidence de l'EPFL. Pourquoi l'Ecole ne lancerait-elle pas sa propre revue?
Ce serait une très bonne idée. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut ordonner d'en-haut. Cela doit venir de la communauté des chercheurs. Si elle décide de quitter la voie traditionnelle, alors cela se fera. Mais ce n'est pas moi qui décide. Un processus de ce genre suppose un changement de culture chez les chercheurs.
Est-ce que des chercheurs, ailleurs, ont déjà emprunté d'autres voies?
Oui. Le célèbre mathématicien Timothy Gowers de l'Université de Cambridge a fondé la revue "Discrete Analysis" avec d'autres chercheurs. C'est une revue virtuelle. Le comité éditorial peut se concentrer complètement sur l'évaluation par les pairs, car c'est une entreprise externe qui s'occupe de la gestion des articles entrants. Les coûts sont d'environ 10 francs par manuscrit – jusqu'à mille fois moins qu'avec une revue traditionnelle.
En 2012, un article dans Nature montrait que sur 53 études "majeures" sur le cancer, 47 n'étaient pas reproductibles. Comment est-ce possible?
Il faut être juste et rappeler que dans certains domaines, la recherche est plus difficile que dans d'autres. En médecine, par exemple, on dispose seulement de faibles quantités de données parce qu'on travaille avec des êtres humains. La statistique pose souvent problème et avec elle, la reproductibilité.
Mais la crise de la reproductibilité concerne aussi d'autres domaines, comme la biologie, dans lesquels on peut choisir la quantité de données avec lesquelles travailler.
J'ai déjà entendu l'argument: "L'autre groupe n'a pas réussi à reproduire tel résultat parce qu'ils ne sont pas aussi bons que nous." Certains chercheurs possèdent un talent particulier; ils gèrent si bien les organismes qu'ils réussissent des expériences que d'autres n'arrivent pas à reproduire. Néanmoins, je pense que c'est une faiblesse, car l'objectif de la science est une reproductibilité complète.
N'est-ce pas simplement dû à de la triche?
Cela arrive parfois, mais ce n'est pas la norme. Il ne faut pas oublier que les chercheurs sont en concurrence. Celle-ci est un peu trop forte aujourd'hui. Cette pression peut pousser un chercheur à publier des travaux inadéquats.
La concurrence est donc mauvaise pour la recherche?
Non, je ne simplifierais pas à ce point. En science, l'enjeu a toujours été d'être le premier à faire une découverte. C'est ainsi que nous faisons avancer la recherche, en étant plus malins et meilleurs que les autres. C'est le propre de la recherche de se mesurer dans la compétition.
Où est le problème, alors?
Il est devenu difficile, notamment pour les jeunes gens, d'être de vrais chercheurs. Il y a cinquante ans, on avait encore le loisir de méditer sur le monde et de générer de nouvelles idées. La recherche représente désormais un business. Le public, le politique et l'économie privée pensent qu'avec elle, on injecte de l'argent d'un côté pour obtenir à l'autre bout et un peu plus tard des résultats pratiques. Mais bien entendu, les choses ne se passent pas ainsi. La recherche a besoin de temps et d'espace pour la réflexion créative.
Mais les chercheurs de l'EPFL ne sauraient se plaindre de leurs bonnes conditions, non?
Il ne s'agit pas que de la Suisse. La recherche est mondialisée. Et on observe des phénomènes inquiétants. Dans certains pays asiatiques, le salaire d'un chercheur dépend des revues dans lesquelles il publie. C'est contestable, car de la sorte, on encourage directement des comportements malhonnêtes.
Et cela a des conséquences sur la Suisse en tant que place de recherche?
Oui. Les jeunes chercheurs sentent une pression à la publication. A partir du contenu d'un article, ils en font trois. Ça en impose davantage sur leur liste de publications. Nous constatons aussi cela au niveau des demandes d'évaluations. Leur nombre a explosé ces dernières années. Le système est complètement noyé. La qualité reste évidemment le parent pauvre.
Qu'est-ce que la science ouverte peut améliorer au niveau du système actuel?
Si nous passons à la science ouverte, nous publions moins d'articles et de meilleure qualité. Ils peuvent être vérifiés plus rapidement lors du processus d'évaluation, car tout est documenté.
Quelles mesures concrètes prévoyezvous de prendre à l'EPFL pour encourager la science ouverte?
Je veux soutenir une culture dans laquelle les domaines qui sont déjà avancés sur le chemin de la science ouverte influencent les autres disciplines, afin que celles-ci y participent aussi. Nous mettons à disposition un outil pour aider les chercheurs à facilement placer leurs données en ligne, ce qui permet à d'autres de les vérifier par la suite. Mais cet instrument doit aussi encourager la collaboration entre différents champs de recherche. En sciences de l'environnement, par exemple, on n'a pas forcément l'habitude de gérer d'importantes quantités de données. Les mathématiciens ou les informaticiens pourraient ici prêter main forte.
Comment motivez-vous les jeunes chercheurs à adopter l'open science?
Je leur dis: le principal pour ta carrière, c'est que ton travail ait un impact important. Si tu mets tes données en ligne, il devient plus visible, et les gens te font confiance, d'où une influence plus grande. Je ne peux pas leur en donner l'ordre. Ils doivent parvenir eux-mêmes à cette conclusion.
Atlant Bieri est journaliste scientifique libre.